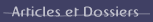Une arnarque ?
Par Dominique Montay.
Il n’y a pas si longtemps, sur Le Village, vous avez pu lire une review des six premières saisons de la série « Hustle ». On vous y annonçait que la saison 7 allait débarquer. Et elle est arrivée sur les écrans britanniques. Et au Village, quelqu’un l’a vue (moi). Et là, grand dilemme. Est-ce que j’en parle tout de suite dans un quinzo, ou est-ce que j’attend six ans pour faire une review des saison 7 à 12 ? J’ai tranché. J’en parle dans le quinzo.
Maintenant que j’y pense, ça aurait été amusant de faire une entrée en matière pour lancer un sujet, pour au final parler d’un autre dans le développement. Ç’aurait été novateur, risqué, couillu. Et idiot. Mais amusant quand même.
Les saisons d’« Hustle » ne sont composées que de six épisodes. C’est extrêmement court, et oblige la série à imposer des épisodes forts, ce qu’elle réussissait de façon très alternative ces dernières années. Et cette année, c’est définitivement une année sans. Le casting est repris à l’identique depuis 2 saisons déjà. La dynamique, j’en parlais déjà sur les saisons précédentes, fonctionne toujours bien, n’impliquant pas de personnage-boulet. Adrian Lester déroule son jeu sans accroc, les deux jeunes sont tout autant dans la répétition du schéma connu, Robert Vaughn est employé avec parcimonie (un peu à l’égal de son ancien comparse David McCallum dans « NCIS », par ménagement pour son âge) et Philip Glenister joue les utilités avec bonheur, ces deux derniers ayant même droit à des épisodes centrés sur eux, l’un jouant la mélancolie (Vaughn) et l’autre le comique outrancier (Glenister), deux épisodes qui sont les meilleurs de la saison.
Mais on part d’assez bas. Le premier épisode est censé être un coup de maître, l’équipe s’attaquant à la patronne odieuse d’une agence de mannequins. La description du milieu de la mode y est factice, gavée de clichés, et (c’est un comble quand on accumule autant de facilités) très peu drôle. Seul le final, un poil inattendu, vient sauver cette ouverture du naufrage. Le second nous sert une romance sans intérêt entre un type dont on n’a jamais entendu parler, ex-grand amour d’Emma, et cette dernière. Un épisode poussif, avec en prime l’utilisation d’un personnage d’arnaquée absolument insupportable.
Bis répétita.
Puis vient le gros morceau de bravoure. Ou en tout cas prétendument. L’acteur américain Michael Brandon, dont les français qui regardaient FR3 dans les années 80 se souviennent de « Mission casse-cou » (ou pas), une des séries les plus coûteuses du Royaume-Uni (à l’époque), arrive pour jouer un « coffreur » d’arnaqueur, réputé le meilleur, et qui par le passé, détruisit la réputation du grand papa d’Albert Stroller. Ç’aurait pu être une réussite, c’est au final un épisode qui épouse tellement les réflexes de base de la série (avec les fameux doubles-twist final, et la dissimulation d‘information) qu’on n’y est jamais surpris.
Le 4e épisode intègre le personnage de Benny, un vieil arnaqueur qui a perdu la main et doit une fortune à un type pas sympa du tout. Episode dont le seul intérêt tient dans le prégénérique. Nos 5 arnaqueurs se rendent à l’enterrement de Benny avant qu’Ash ne tombe dessus quelques minutes après. L’épisode suivant nous raconte la faillite du club de Railton FC, club de l’enfance d’Ash, miné par des problèmes financiers à cause d’un agent peu scrupuleux. La qualité de cet épisode vient du fait qu’Ash, à la suite d’un accident visuellement stupide, se trouve incapable de mentir. Prémice hautement ridicule, improbable, inconsistant, mais qui a le mérite de changer complètement la dynamique de la série et d’y intégrer une réelle tension.
Le dernier, plutôt bancal, tient surtout par la prestation de Vaughn, dont le personnage apprend qu’il a une fille de 20 ans. Cette intrigue casse-gueule au possible ne tient que par le charme et le charisme du bonhomme. Il est d’une justesse incroyable quand il voit cette fille, et il réussit à nous émouvoir dans un final TRES musical (on se croirait dans « Cold Case »), mais habité par son comédien avec grand talent.
Avec cette saison 7, peu de risques ont été pris, de l’écriture à la production. On sent une machine huilée, propre, mais qui ne se fait que très rarement violence. Sans réclamer que la série devienne profonde et introspective, on aimerait qu’elle gagne en folie et qu’elle prenne plus de risque. A force de jouer la facilité et la répétition, cette honnête série sans prétention qui est aussi vite regardée qu’oubliée prend un chemin qui la mène tout doucement vers une disparition dans l’anonymat le plus complet, et ce même si la série a été renouvelée pour une 8ème saison en 2012.
Scénariste, un métier solitaire ?
Par Sullivan Le Postec.
Bourges, ce n’est pas seulement le Printemps. Du 30 mars au 2 avril, s’y tenait le Festival International des Scénaristes, 14ème du nom – l’âge de se mettre au guidon de sa première mobylette, pilotée pendant les cérémonies d’ouverture et de clôture par sa Déléguée Générale, Isabelle Massot.

- Isabelle Massot
- et la mobylette des 14 ans du festival
Je m’y trouvais, invité par le scénariste Benjamin Dupas, à participer avec lui-même ainsi qu’avec le scénariste Quoc Dang Tran à une table-ronde autour de la notion de genre, dans son volet consacré à la télévision. L’occasion de faire le constat du manque de diversité des séries françaises, et de se demander comment, au niveau du scénariste, on pouvait en apporter davantage, en s’appuyant sur l’exemple de la télévision britannique.
Mais ce fut aussi, et peut-être surtout, l’occasion de découvrir ce festival unique en son genre, où l’on passe quatre jours autour de cet étrange objet qu’est le scénario. Au-delà des tables-rondes et autres leçons de scénario, le Festival International des Scénaristes est surtout rythmé par des événements diablement originaux. Le marathon d’écriture du court-métrage, bien sûr (des jeunes auteurs ont 48 heures pour écrire un court à partir d’un sujet donné) mais aussi les Criées aux scénarios, le Workshop « Écrire une bible de télévision », le Forum des auteurs, l’Atelier réparation...
Autant d’occasions de créer des rencontres, des échanges d’expériences et de points de vue, et de mener des débats enflammés sur la dramaturgie. Autant d’occasions, donc, de mettre à mal certains clichés. Solitaire, le scénariste ? Isolé dans son bureau-tanière face à son clavier ? Bourges donnait de bout en bout l’impression opposée.
Peut-être parce que tous ces événements innovants rythment ses activités, et favorisent les transmissions, plus sûrement parce que l’organisation du Festival veille avec soin à cette ambiance particulière, et que les participants jouent clairement le jeu, l’atmosphère à Bourges est très particulière. Donner, recevoir, échanger, ce n’est pas un à coté de ce festival, c’est visiblement la raison première pour laquelle la plupart de ses participants sont là.
Rien à voir, du coup, avec nombre de festivals où les évènements s’enchainent sans que la mayonnaise ne semble jamais prendre, et dont l’ambiance évoque avant toute chose l’hiver polaire. Pendant ces quatre jours, Bourges déborde d’une forme de chaleur à coté de laquelle il est difficile de passer.
Il y a une plus-value évidente à jouer collectif, à croiser les regards, à s’enrichir de l’autre, de son expérience, de son point de vue. Le défi du renouvellement de la fiction télévisée française est très grand, et il faudra s’y mettre à plusieurs pour le relever. L’intelligence collective vue à Bourges, la volonté manifeste de se remettre en cause, et de réfléchir ensemble, c’est le genre de choses qui laissent entrevoir un espoir au bout du tunnel.
Dernière mise à jour
le 5 avril 2011 à 21h05
Articles par Dominique Montay
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français