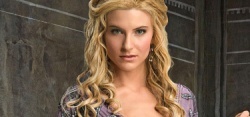Car ces six épisodes sont une chouette réussite.
Bien qu’il y ait eu assez de matière pour tenir sur un plus long terme, les retournements de situation s’enchaînent très vite mais sans jamais paraitre trop abruptes. Car au lieu de rebondissements pour relancer une intrigue, on nous offre plusieurs petites conclusions amenant à de plus grandes. Pour une série impopulaire, il est rare d’avoir la possibilité de créer une fin satisfaisante.
Et pour bien finir, quoi de mieux que d’offrir la récompense tant attendue à l’héroïne, avant qu’un dernier drame ne la relance dans un grand acte de bravoure qui punit tous les vilains ? Certes, c’est très grossier (remettre un prix à une tueuse professionnelle parce qu’elle a tué "pour le Bien", c’est vraiment fort !). Mais dans cet univers qui a toujours fait dans l’exagération, cela passe parfaitement. Et il ne reste plus qu’à sourire que chaque personnage y trouve son compte.
Il est dommage que Nikita n’ait jamais attiré plus d’attention, y compris sur ce site, car elle n’a jamais été particulièrement aussi mauvaise qu’elle en donne l’air. Son souci à créer le moindre intérêt a surtout résidé dans un sentiment de redite inutile. Ju avait très bien évoqué ce problème (et quelques autres) dans sa review du Pilote. Et cet avis fut parfaitement juste durant au moins la première saison. Il m’aura fallu un moment d’ennui profond deux ans plus tard pour y jeter un oeil et me réaliser qu’elle était tout à fait regardable.
Oui, ce n’est pas vraiment un grand compliment. Nikita est devenue plutôt divertissante, avec une Maggie Q devenant moins monolithique, une série d’action correcte avec même de très bons moments. Ce qui semble être la façon dont mes collègues décrivent Elementary en ce moment, au milieu des autres procedurals. Je ne suis pas particulièrement attirée par Elementary parce que ce n’est pas le choix qui me manque dans le genre. Par contre, il m’est plus difficile de bouder ma petite dose d’espionnage international ridicule avec une protagoniste qui bastonne du vilain à chaque épisode.
Je ne sais pas pourquoi je l’ai finalement si mal traitée, à ne la visionner qu’en période creuse et dans un désordre total. Parce qu’elle avait cette particularité à laquelle j’aurais du prêter plus d’attention. En séparant Nikita et Alex des autres pour atteindre Amanda, ce final m’a rappelé rappel de ce qui fait le coeur de cette série.
Nikita, c’est surtout une histoire de femmes, avec leurs liens et leurs oppositions.
A force de suivre tout le groupe s’étant formé autour de Nikita, on finissait par oublier que la base de tout est ce trio de femmes s’étant influencées mais réagissant différemment à leurs traumatismes. Que le triangle central formé du héro, de l’allié et de l’ennemi ne contienne que des femmes offre pourtant une dynamique assez rare pour être remarquée et appréciée.
On pourrait argumenter le cas de Michael, dont le rôle importe beaucoup, mais il n’a jamais été à la base des enjeux de la série. Comme Birkhoff, Owen ou Sonia, il s’est allié progressivement à la cause de Nikita. Et c’est bien ce groupe de renégats tentant de sauver le monde d’ignobles complots que l’on suit de façon générale. La formule classique de famille recomposée et unie dans un même but.
Mais sans Alex, ce miroir infiltré chez l’ennemi, l’histoire se serait arrêtée à la simple fuite de Nikita : soit le but des précédentes incarnations, retourné ici comme point de départ.
Alias restera la série supérieure et celle qui restera dans les mémoires. Mais il est dommage que l’histoire de Sydney Bristow ne se soit façonnée qu’autour d’hommes : son père, son contact, son ennemi et même un vieil inventeur. Il lui fallu cinq saisons pour voir l’idée d’une femme pouvant lui succéder, et aucun attachement fort entre elles n’en est ressortit.
Sur ce plan-là, les prochaines séries de ce genre pourront prendre un peu exemple sur Nikita.