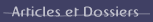Cet article a été écrit pour et initialement publié sur le site du Front de Libération Télévisuelle. Il a été légèrement amendé pour cette republication sur le Village.
Paroles de scénariste français, à propos de la fiction télévisée : ‘‘Les chaînes ne produisent quasiment plus que du récurrent et très peu d’unitaires. Cela bride la créativité des scénaristes qui doivent se conformer aux bibles déjà existantes’’ [...] ‘‘La télé industrielle est pour moi inévitable. On va de plus en plus vers le nivellement et la désincarnation des scénarii.’’
Ces propos sont alarmants, en cela qu’ils partent d’un problème réel mais en occultent les causes et esquissent une réponse qui, dès lors, ne porte aucune possibilité d’amorcer sa résolution. Et le plus alarmant est que ces propos sont régulièrement véhiculés par toute une part de la profession.
Une structure de production artisanale
Les créatifs français manifestent souvent un rapport trouble a la télévision. Rares sont ceux capables de l’appréhender pour ce qu’elle est : un média à part, avec ses spécificités ; elle tend plutôt à être vue comme un cinéma bis, un terrain de jeu enfin accessible pour ‘auteurs’ frustrés. Et c’est bien de cela qu’il est question, derrière les affirmations rapportées plus haut.
Le cinéma est par essence un terrain d’artisanat, parce que chaque film est un prototype, où absolument tout doit être recommencé, à chaque étape : écriture, développement, tournage, distribution... Il l’est encore plus qu’ailleurs en France, où il a été pris en main par une génération de réalisateurs devenus auteurs, prenant effectivement en main la totalité d’un métrage.
La fiction télévisée doit-elle - peut-elle - être envisagée sur le même mode ? Un éloignement des méthodes de production artisanales est-il voué à conduire à brider la créativité, niveler et désincarner les scénarii ?
Quel meilleur moyen de proposer une réponse à cette question que de se confronter au principal exemple dans le monde de télévision aux méthodes de production industrialisées ? Impossible de ne pas voir en la télévision américaine une « usine » à produire de la fiction et, donc, des séries. Les studios sont rodés à leur mise en place. Quantité de personnel formé existe pour occuper tout les postes dans la production. Et si, vues d’ici, les séries ont longtemps été perçues avec condescendance, force est de constater que les créatifs, à défaut de la population générale, s’accordent désormais pour l’essentiel à y voir une source inépuisable de fictions courageuses, innovantes, riches, surprenantes, en perpétuel renouvellement. Il est donc déjà clair qu’une telle industrialisation n’est pas en soit un facteur induisant une baisse qualitative de la fiction.
En France, nous sommes effectivement encore loin d’une telle organisation du système. C’est de toute façon difficile compte-tenu du fait que le volume horaire de fiction produite est d’ailleurs faible, même en comparaison avec nos voisins européens. Ainsi, en 2001, la France a produit 553 heures de fiction contre 761 pour l’Italie, 1279 pour l’Espagne, 1463 pour le Royaume Uni et 1800 pour l’Allemagne. Un rapport du CSA pointait d’ailleurs très récemment une baisse inquiétante de ces volumes depuis quinze ans.
En simplifiant, la fiction est structurée autour de trois pôles : les créatifs, les producteurs et les diffuseurs.
Si les écoles et autres formations aux métiers du spectacle se sont développées ces dernières années, nombre d’entre elles sont encore assez détachées des réalités du métier. In fine, les créatifs doivent gérer une bonne part de leur apprentissage par eux-même. Et, faute de moyen, pas grand-chose n’est prévu pour la formation interne, à moins qu’on appelle ainsi les pools d’écriture gratuite autour d’Un Gars, Une Fille qui existaient à une époque.
Au sein des chaînes, le contrôle de la ligne éditoriale est, de manière plus ou moins centralisée (plutôt plus que moins, en général...), géré par le Directeur de la fiction. La France est, à ce niveau, prise dans une situation quasi-unique : TF1 réalise quotidiennement des parts de marché exceptionnelles, de 40, voire 50%. C’est à dire que près de la moitié des gens présents devant la télévision un soir donné se trouve bien souvent sur TF1. Il n’existe qu’un seul moyen de rassembler autant : ne déplaire à (presque) personne. A ce niveau, le ressort n’est donc pas l’adhésion, mais le consensuel. Chaque idée déstabilisante, voire même choquante, c’est donc potentiellement un téléspectateur qui zappe. Dans ces conditions, impossible d’être personnel. En face, sur les chaînes concurrentes, difficile de résister. Car si innover représente l’espoir, à moyen ou long terme, de grappiller du public, cela revient sur le moment à prendre un risque majeur : si la fiction ne plaît pas, on précipite le marché vers le programme consensuel de TF1 dont on contribue alors a augmenter la prédominance.
La nébuleuse des producteurs constitue l’interlocuteur des chaînes pour le développement des fictions. En 2001, 78 producteurs différents sont intervenus dans la production de fiction télévisée en France ; il y en avait 73 au Royaume Uni, qui produisait donc pourtant 3 fois plus d’heures de fiction. De plus, en France, 89% de ces producteurs étaient indépendants (non liés à un diffuseur) contre à peine 33% au Royaume Uni.
C’est la manifestation la plus concrète du caractère non industriel de la production française : de petites sociétés, avec peu de personnel et peu de moyens, qui vivent, ou survivent, de la production d’un petit volume chaque année. De nombreuses structures vivotent en effet de la production d’une poignée, voire d’un seul, unitaire chaque année.
Quelles conséquences ?
La multiplicité et la faiblesse structurelle de bon nombre de société de productions de fiction télévisée françaises les placent à la merci des diffuseurs. Si une société ne vit que d’un tout petit volume de production, il est bien clair que si elle ne trouve pas d’accord de diffusion avec une chaîne pour pouvoir produire une œuvre, cette société disparaît purement et simplement !
Quand un producteur en rendez-vous avec un directeur de la fiction met dans la balance de la négociation un ‘‘si je ne tourne pas cet unitaire cette année, je dépose le bilan’’, comment pourrait-il appuyer la position du créatif vis à vis de la chaîne qui exigerait un aplanissement de l’œuvre produite ? Et c’est là, déjà, ne pas partir du principe qu’il a au préalable procédé à cet aplanissement de manière préventive, avant ledit rendez-vous (en pratique, le scénariste se serait en fait auto-censuré au préalable dans l’espoir que son projet soit accepté par un producteur qui puisse aller le défendre auprès d’une chaîne...).
L’artisanat des sociétés de production, qui vire parfois à la limite de l’amateurisme, ne fait que renforcer leur faiblesse vis à vis de diffuseurs à l’origine du nivellement par le bas de la fiction française, et leur laisse la mainmise sur le système.
Une des illustrations en est que c’est seulement aujourd’hui que commence à se développer en France le format de 52 minutes alors qu’il est une des clefs de la prospérité d’un producteur.
En effet, un diffuseur rentabilise les investissements placés dans une fiction par sa diffusion : écrans publicitaires encadrant et/ou interrompant le programme et aussi fonds d’Etat pour le service public. Un producteur, lui, a du mal à survivre de cette diffusion initiale. Avec de la chance, elle l’amène à l’équilibre, mais s’il souhaite disposer de fonds pour investir dans du développement et produire de nouvelles fictions, le producteur vise plutôt les bénéfices. Ceux-ci sont générés par la suite. Or la fiction française est par nature inexportable. Les chaînes ont développé des formats spécifiques qui ne passent pas nos frontières. Ce qui s’exporte c’est la série de 52 minute avec un nombre conséquent d’épisodes. Les chaînes françaises diffusent des collections de téléfilms de 90 minutes à héros récurrents qui se tournent au rythme de 4 ou 5 par an, rendant difficile le franchissement de la barre presque réglementaire des 50 épisodes. Et même aujourd’hui où le 52 se développe enfin, parce qu’il est devenu l’intérêt de tous, c’est souvent au rythme de 6 épisodes par an, 12 pour les séries à succès de France 2 que sont PJ et Avocats & Associés.
Les producteurs sont donc condamnés à vivre avec un trésorerie limité qui les empêche de financer du développement. Créer une série, ça coûte cher, et il est illusoire de penser que tous les projets commencés puissent déboucher sur quelque chose. Pourtant, on se retrouve trop souvent aujourd’hui à tourner des projets bâtards parce qu’on ne peut pas financer plus de développement.
La série est par nature le médium naturel de la fiction télévisée, car la télévision est un média de rendez-vous, de fidélisation, de travail dans la longueur et d’empathie. Bien sûr, il faudra toujours des téléfilms unitaires, mais les sujets qui exigent un traitement de 90 minute à la télévision plutôt qu’au cinéma sont rares. Force est de constater que les unitaires ‘incarnés’ et ‘créatifs’ ne sont pas légion, faisant au contraire plutôt office d’exceptions au milieu d’histoires pâles, maintes fois vues et qui, au fond, ne parlent de rien.
Une industrialisation des méthodes de production, c’est à dire concrètement le basculement vers la série, n’est donc pas une trahison du média, mais un ajustement à ce qu’il requiert ! Elle entraînera inévitablement une baisse du nombre de producteurs, c’est pourquoi ils s’y sont souvent opposés à titre individuel alors qu’elle est dans leur intérêt global. Mais ce faisant, elle permettrait aussi en renforçant les structures subsistantes de commencer à modifier quelque peu les équilibres des forces entre producteurs et diffuseurs.
Dans un second temps, la poursuite de cette industrialisation représente pour les créatifs non pas une entrave, mais autant de possibilité de s’immiscer dans les intervalles pour mieux personnaliser leurs écrits.
Quand la production est lancée, il est difficile d’arrêter la chaîne au moindre prétexte, car cela revient à prendre le risque de ne pas s’avérer capable de répondre à la demande. Le contrôle exercé par les diffuseurs, s’il ne peut pas disparaître, se voit alors forcément réduit. Aux Etats-Unis, une fois la production d’une série lancée, un épisode est écrit trois mois avant sa diffusion à l’antenne. En France un année ou plus séparent ces deux moments ; il est bien évident que c’est d’autant plus d’occasions pour la censure de faire son travail. Et, bien sûr, la relation entre les pôles créatifs, producteurs et diffuseurs générée par ces conditions de volume haut est fondamentalement différent, un véritable rapport de confiance pouvant s’installer entre les parties.
Les inquiétudes irraisonnées...
On a donc vu que s’inquiéter d’une industrialisation de la production de fiction télévisée n’est pas nécessairement pertinent. Ca l’est d’autant moins, en conclusion, qu’une telle industrialisation n’est pas pour demain, tant toutes les structures dans l’ensemble de nos trois pôles, créatifs, diffuseurs et producteurs n’y sont pas adaptées ! Les créatifs ne savent pas faire de la série : les scénaristes peinent à en développer et n’arrivent pas à constituer d’équipe d’écriture, une nécessité pour livrer une vingtaine d’épisodes par an ; les réalisateurs sont terrifiés par la série car elle incarne leur perte d’influence créative sur la télévision, eux qui ne peuvent s’imaginer autrement qu’ « auteurs ». Les producteurs sont éclatés en une multiplicité de sociétés sans le sous. Les diffuseurs n’ont pas de cases pour la série et ont accoutumé l’ensemble du public français à d’autres formes de narration inexportables, difficiles à renouveler et qui cesseront de marcher avec la fragmentation du marché, inévitable à long terme.
Tous les acteurs de la filière doivent donc s’unir face à la lourde tâche que représente aujourd’hui un basculement des méthodes actuelles vers des méthodes industrielles... mais c’est seulement parce qu’elles partagent la responsabilité de l’appauvrissement structurel et narratif de la fiction française depuis plusieurs décennies.
Post Scriptum
Sites Internet
- Union Guilde des Scénaristes
- www.scenario-mag.com
- Scénartistes.com
Presse
- La Gazette des Scénaristes, numéro 20, "Séries TV : le mal français"
Dernière mise à jour
le 17 février 2011 à 00h49
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
Dans la même rubrique
- POLÉMIQUE — Après « Inquisitio », France et fiction : le divorce
- DOCTOR WHO — ‘‘Let’s do it !’’ / ‘‘I can’t do it !’’ : anatomie d’une collaboration galloise
- FOCUS — La fiction télé française et la politique
- PRODUCTION — Les budgets trop lissés font-ils des séries lisses ?
- RÉGULATION — Et tranquillement, le CSA proposa de tuer la fiction française...