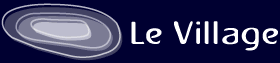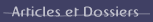Cet article a été écrit pour et initialement publié sur le site du Front de Libération Télévisuelle. Il a été légèrement amendé pour cette republication sur le Village.
Dans un précédent article, nous évoquions l’inadaptation structurelle du Paysage Audiovisuel Français, et la manière dont elle participait de la faiblesse de sa fiction. Pourtant, et même si cela arrangerait bien tout le monde, les conditions de production de la fiction télévisée en France ne peuvent être tenues seules pour responsables du délabrement de notre fiction ces vingt à trente dernières années. Les créatifs, et en premier lieu les scénaristes, portent une véritable part de responsabilité : celle de ne pas avoir cherché à comprendre ce média, et à s’en emparer.
La réflexion interrompue
Tout repose sur un énorme malentendu. La majorité des scénaristes actuels, et en particulier ceux qui travaillent, n’ont absolument pas compris ce qu’était la télévision. Ils se sont inscrits sans trop y réfléchir à deux fois dans la ‘tradition’ française de son utilisation pour la fiction. La télé est vue avec condescendance comme une sous-plateforme où on donne à la chaîne de quoi tenir éveillée une grosse « ménagère de moins de 50 ans » pas très futée, avachie sur son fauteuil en cuir “vu à la télé”. Parmi les créatifs, il n’y a eu personne, depuis 20 ans, pour conceptualiser ce que pouvait être la télévision. Personne pour réfléchir sur son sens et sa fonction. A leur décharge, on pourra signaler qu’en dehors des créatifs eux-mêmes, il n’y a pas vraiment eu beaucoup de monde pour le faire à leur place... C’est que le dédain de la télévision a longtemps été généralisé. Et qui réfléchi à ce qui est méprisé ?
Nous en sommes donc resté là où la dernière réflexion nous a mené. Cette réflexion était celle de Tito Topin qui, dans la deuxième moitié des années 80, inventait « Navarro » pour une TF1 nouvellement privatisée. Elle répondait aux impératifs de l’époque, ceux de TF1, qui voulait forcément s’éloigner de l’artisanat total des premiers temps (qu’on en vient à regretter, lui qui a donné à la France la quasi-totalité de ses télé-fictions mémorables). Rien d’étonnant, donc, à ce que notre fiction d’aujourd’hui ait 20 ans de retard. Et ce n’est pas là qu’une formule : à la télévision américaine, rien n’est plus proche, format de 52 minutes excepté, de nos ‘héros citoyens’ à histoires bouclées que bon nombre de séries des années 80. Pendant que le monde avançait et que la fiction télévisée se sophistiquait et se réinventait, la France avait appuyé sur le bouton pause à l’époque de la « Croisière s’amuse ».
Les règles de bases de cette conception de la télévision reposaient sur des collections portées par un personnage charismatique qui fidéliserait le téléspectateur autour d’une formule par ailleurs immuable, hors impondérables (vieillissement des acteurs et, en particulier des personnages enfants). Ainsi, on obtient une fiction quasi-pérenne : chaque épisode peut être rediffusé au milieu d’une flopée d’inédits quasiment sans que l’on ne s’en aperçoive (d’ailleurs, les chiffres d’audience de rediffusion d’un ‘‘Navarro’’ ou d’une ‘‘Julie Lescaut’’ ne laissent effectivement pas voir de différence avec un inédit, ce qui est bien sûr facilité par leur longévité et leur grand nombre d’épisodes). De plus, ces fictions sont adaptées à un marché hautement concentré sur un petit nombre de chaînes ou de réseaux. Elles se doivent donc de plaire à l’ensemble de ceux qui se trouvent devant leur écran en prime time : c’est-à-dire quasi tout le monde. Un seul ressort permet de réunir de manière régulière et répétée les 7 à 77 ans : le consensualisme.
Du coup, les personnages sont invariablement des gardiens de la morale altruistes, sans peurs et sans reproches, avec une vie un peu difficile - il faut montrer comme ils sont forts et s’en sortent bien - mais pas trop - gare à ne pas déprimer la ménagère ! Et ils sont volontiers donneurs de leçon : on ne leur en veut pas, ils ont toujours raison.
Un média à part entière
Cette manière de concevoir la fiction télévisée n’est pas une invention qui repose sur rien. Elle consiste en effet, consciemment ou inconsciemment de la part de ses promoteurs, je ne saurais en juger, en un positionnement comme un parent pauvre du grand écran.
Récemment, je lisais un scénariste français qui écrivait : « Les séries américaines que vous citez vous plaisent parce qu’elles sont "actuelles" et très efficaces. Mais dans 10 ans ? ». On cherche en effet à l’inscrire dans la durée ; on souhaite que la fiction puisse être vue puis revue des années plus tard, justement à la manière dont la télévision a pris l’habitude de rediffuser en boucle un film de cinéma. Cette façon de traverser le temps serait le gage de la qualité d’une œuvre. Et comme, par manque de temps et de moyens financiers, il n’est pas possible, à la télévision, de construire cette pérennité sur une véritable démarche de recherche artistique, comme c’est le cas au cinéma, on a voulu l’obtenir en réduisant la fiction télévisée au plus petit dénominateur commun.
Bien sûr, il est dès le départ absurde de prétendre que, sous prétexte qu’elle est solidement ancrée dans son époque, une fiction ne puisse pas vieillir bien. Simplement, cela sera réservé aux meilleures d’entre elles. Peut-être y a-t-il là un complexe à franchir, celui de n’être que le créateur d’une œuvre qui divertisse son époque, mais ne soit pas suffisamment forte pour être encore évocatrice des années plus tard ?
Surtout, cette petite phrase témoigne d’une incompréhension totale de ce qu’est la télévision. Et particulièrement de la place qu’elle a prise de nos jours, en même temps qu’elle pénétrait de plus en plus dans les foyers, que la concurrence s’installait, et que le marché, lentement mais inéluctablement, se fragmentait. Média à part entière, elle est justement le vecteur d’une immédiateté, le reflet perpétuel de son époque. Une bonne fiction télévisée, une qui sollicite l’implication émotionnelle de son spectateur, porte la marque des débats et des pensées de son temps. Elle confronte le téléspectateur à son époque et suscite son adhésion par cette convergence. En France, cette fonction est considérée comme réservée aux programmes de flux (émissions de plateau).
Pourtant, cette implication est la clef. Elle manque cruellement à notre fiction. Et si celle-ci peut se targuer de réunir encore un audimat excellent (mais, à moyen terme, et même si la suprématie de la première chaîne ralentit les évolutions, cette stratégie ne tiendra pas), ce n’est pas un hasard s’il n’y a aucun phénomène « fan », ni produits dérivés.
De nouvelles approches
On suppose malheureusement que, laissée en autarcie, la France en serait restée longtemps là. Mais la multiplication des chaînes qui rendait progressivement dépassée cette conception de la fiction est aussi celle qui a amené et mis en avant la fiction étrangère, essentiellement américaine. En une dizaine d’années, elle a fait connaître et donné le goût d’une fiction moderne, engagée, incarnée, portée par des créateurs qui laissent leur marque : une démarche artistique forte.
On a vu une véritable culture se créer, en dépit des difficultés, portée par des réseaux de ‘fans’. Dans un premier temps ces fans représentaient une sorte de levier pour la fiction française parce qu’ils faisaient simplement envie, dans une démarche marketing, aux diffuseurs. Mais pour pouvoir réellement les toucher et se les approprier, encore aurait-il fallu que des scénaristes y comprennent quelque chose pour pouvoir s’en inspirer.
Bien sûr, je grossis un peu le trait : ces scénaristes existent et ont existé. Mais, perdus au milieu d’une masse de créatifs sans recul ni réflexion sur le support qui était le leur, ils ne représentaient pas une force susceptible de se faire entendre des chaînes. Ce n’est pas non plus un hasard si la fiction américaine est celle d’un pays aux syndicats de scénaristes puissants, capables de déclencher une grève générale privant le pays de toute fiction télé.
Aujourd’hui, pourtant, les choses sont en train de changer. Et cela, bien sûr, a tout à voir avec la nouvelle génération entrée en action. Car le mouvement des fans arrive à maturité. Il s’est emparé de la question, a mené la réflexion sur le medium qui faisait jusque là défaut (l’augmentation significative de la recherche universitaire sur les séries est, à ce niveau, un signe évident).
Plus elle s’affirmera, plus cette génération aura la possibilité de provoquer cette révolution. En particulier dans cette période charnière que nous vivons, où d’autres transformations majeures sont à l’œuvre, tel le basculement massif vers le 52 minutes.
Pour la première fois depuis longtemps, un regain d’optimisme sur l’avenir de la fiction française est possible et justifié.
Dernière mise à jour
le 17 février 2011 à 00h50
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
Dans la même rubrique
- POLÉMIQUE — Après « Inquisitio », France et fiction : le divorce
- DOCTOR WHO — ‘‘Let’s do it !’’ / ‘‘I can’t do it !’’ : anatomie d’une collaboration galloise
- FOCUS — La fiction télé française et la politique
- PRODUCTION — Les budgets trop lissés font-ils des séries lisses ?
- RÉGULATION — Et tranquillement, le CSA proposa de tuer la fiction française...