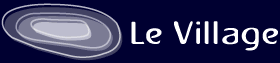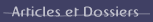Après « Juste une question d’amour », le réalisateur Christian Faure revient au téléfilm gay avec « Un amour à taire », sur la déportation des homosexuels pendant l’Occupation. France 2 rediffuse mercredi 6 février ce téléfilm qui date d’avril 2005. Une occasion de découvrir une production engagée et de qualité.
Paris sous l’Occupation. Par une nuit pluvieuse, une jeune femme échappe aux Allemands et s’enfuit, arrachant son étoile jaune...
A la blanchisserie Lavandier, une cliente s’inquiète du sort du deuxième fils de la famille. Il est toujours au sanatorium, répond le père, Armand, mais les médecins promettent de le rendre guéri de sa tuberculose avant Noël. Elle s’en va, sans remarquer les quelques regards inconfortables échangés. Lorsque Armand a tourné le dos, la mère montre à l’aîné, Jean, un paquet qu’elle a préparé et qu’il doit remettre à son frère, sans que le père ne le sache.
Aux abords de la boutique, Jean rencontre Sarah, la jeune fille que nous venons de voir s’échapper. Il s’agit d’une amie d’enfance connue en vacances à La Baule où ils allaient chaque année. Trahis par un passeur qui leur avait promis l’Angleterre, toute sa famille a été tuée. Jean emmène Sarah chez un ami, Philippe, qui lui reproche d’avoir agit imprudemment - mais lui même lui cache ses propres actes de résistance active.
Au dîner, Sarah explique à Philippe que Jean est son amour d’enfance, qu’en fait elle est toujours amoureuse de lui. Pendant ce temps, Jean rend visite à Jacques, son frère...en prison, où il a été incarcéré pour de petits trafics. En ces temps où tout se paye, le père pourrait le faire sortir. Mais il s’y refuse, décidé à ce qu’il fasse sa peine, à laquelle il reste encore deux mois, pour s’amender. Jean retrouve Philippe chez lui. Ils s’embrassent mais Jean se débat un peu, arguant que Sarah est là et pourrait les surprendre, ce qui ne manque pas d’arriver. Sarah s’enferme dans sa chambre pour la nuit.
Dans les jours qui suivent, Sarah s’enfonce dans la déprime, et Jean doit lui montrer beaucoup d’attention, ce qui fait naître chez Philippe une certaine jalousie que Jean doit également gérer. Laissée seule un après-midi, Sarah découvre la cache où Philippe dissimule des faux papiers, et une arme. Elle s’en empare et va retrouver le passeur. Face à lui pourtant, sa détermination s’éteint et elle renonce à le tuer. Il tente de lui prendre l’arme des mains, un coup de feu part, le passeur est blessé.
Quelques jours plus tard, Philippe ramène à Sarah des faux papiers. Elle devient Yvonne Bruner et, sous cette identité, Jean l’a fait engager à la blanchisserie. Mais le père n’est pas long à remarquer la complicité entre elle et Jean, et recommande qu’il tienne à distance : il ne saurait tolérer que celui à qui il a décidé de léguer intégralement la blanchisserie se compromette dans une liaison avec une employée.
Bientôt Jacques, que Jean a mis dans la confidence au sujet de Sarah/Yvonne, sort de prison. Il est accueilli avec dureté par son père qui lui indique qu’il sera dorénavant traité ici comme un simple employé. La situation entraîne des tensions entre les frères, et Jacques ne supporte pas que Jean cherche à savoir ce qu’il fait du temps pendant lequel il s’éclipse pendant ses livraisons. En fait, acques a repris ses relations avec ses anciens contacts de trafics. L’officier de police Breton, à qui, contre un pourcentage sur les biens récupérés, il livre des adresse de famille Juives qui ont déserté la ville, qu’il peut facilement identifier à la Blanchisserie.
A une soirée qui rassemble des homosexuels parisiens, Jean partage une danse avec un officier Allemand. Pendant ce temps, Philippe converse avec le Préfet. Celui-ci lui révèle qu’il est dans le collimateur de ses supérieurs et subalternes, et qu’il ne pourra plus fournir de faux-papiers. Il va bientôt devoir passer à la clandestinité. De plus, il lui recommande de ne plus venir ici. Trois agents de la mondaine sont là, observant les convives, prenant des notes.
Tandis que Philippe, Sarah et Jean s’engagent plus avant dans la résistance souterraine, la vie de tous se complique. Armand Lavandier se sent obligé d’afficher dans la vitrine de la blanchisserie un panneau annonçant ‘‘interdit aux Juifs’’.
Jacques poursuit Sarah de ses assiduités. La raccompagnant chez elle, il fait la connaissance de Philippe, qu’elle lui présente comme son cousin. Pour pouvoir offrir à Sarah du parfum de luxe, Jacques met en action ses contacts. Des petites compromissions il est prêt, lui, à accepter, puisqu’il autorise une employée de la blanchisserie à ‘emprunter’ la robe d’une cliente juive qu’ils n’ont pas revu depuis six mois. Au passage, il note l’adresse... Mais Philippe a éveillé la curiosité de Jacques. Il se met à filer le trio qu’il forme avec Sarah et son frère...et ne tarde pas à découvrir la nature des liens qui les unissent vraiment.
Cette découverte ne fait que raviver le sentiment d’injustice de Jacques devant le fait qu’il est constamment traité comme la brebis galeuse de la famille. Il réagit d’abord avec violence. Jean lui explique qu’il ne pouvait pas lui en parler. Dans ce monde, il n’y avait pas d’autre option que le secret.
Le trio devient quatuor et se réunit pour fêter l’anniversaire de Jean. Tandis que Philippe s’inquiète que ce Jacques leur ramène, de toute évidence en provenance du marché noir, l’insistance de Jacques envers Sarah créé de nouvelles tensions, exacerbe les jalousies. Il ne supporte pas qu’elle continue d’aimer son frère. De tension, la situation dégénère en bagarre et Jacques est mis dehors. Il s’invite en pleine nuit chez Breton. Il lui demande de faire arrêter Jean pour soupçons d’actes de résistances, et de le ramener le lendemain à la Blanchisserie en ne manquant pas de signaler qu’il peut remercier son frère pour ses relations. ‘‘Touchant, le fruit pourri qui tente de devenir un héros’’, commente Breton.
Le plan est exécuté immédiatement. Mais tout dégénère lorsqu’un agent remarque que Jean Lavandier est inscrit au ‘fichier des pédés’, suite à la soirée quelques mois plus tôt. Jean va être transféré aux Allemands. Jacques ne peut plus rien faire pour lui, et Breton se montre particulièrement pas intéressé à l’idée de lui venir en aide. Il prend même plaisir à révéler à Jean qui l’a dénoncé. Les contacts de Philippe sont tout aussi inefficaces. Le seul homme qui aurait vraiment pu aider Jean est l’officier Allemand avec lequel il été vu en train de danser. Mais suite à ces accusations, l’homme s’est suicidé. Après l’avoir interrogé, les Allemands transfèrent Jean vers l’Allemagne. Au moment du transfert, Philippe, Sarah et Jacques peuvent l’observer un instant, avant que les portes du wagon ne se referme et que le train n’entame sa marche sinistre vers l’Allemagne, vers les camps. Jacques s’effondre en pleurs.
Les déportés sont triés avant d’être placés dans des camions. Jean rencontre un alsacien, Rudy, affublé du triangle rose, placé pour stigmatiser et humilier les homosexuels. Rudy lui explique que puisqu’il vient de Paris, territoire Français, lui aura sûrement la chance de porter seulement la barrette bleue des asociaux...
A Paris, la situation à la table des Lavandiers a bien changé et c’est maintenant Jean qu’il est interdit de nommer dans les conversations.
Tout dégénère encore un peu plus et Philippe est bientôt abattu par les Allemands pour ses actes de résistance. Sarah se retrouve à nouveau seule et à la rue, et se retourne vers Jacques. Il la recueille et la fait coucher dans la chambre de Jean dans la maison familiale. Jacques révèle à sa mère la vérité sur l’identité de Sarah. Ils se mettent d’accord pour ne pas en parler au père, rien ne doit changer dans leurs habitudes. Officiellement, elle sera sa fiancée.
Au camp de travail, Jean subit les heures de travail et les exercices de « rééducation » où ceux qui ne se conduisent pas « en homme » sont abattus. Rudy s’affaiblit et, bientôt, malgré le soutient de Jean, il s’écroule d’épuisement. Les Allemands le déshabillent, l’emballent dans un sac et le carbonisent au lance flamme. Jean s’empare de la chemise au triangle de Rudy et hurle en Allemand ‘‘Je suis un homosexuel’’. ‘‘Alors tu ne veux pas guérir ?’’ lui demande l’officier en charge. Mais pas question de lui accorder la mort que Jean réclame. Il décide de le transférer et de le confier aux médecins.
Engagé dans la collaboration, Jacques parvient à récupérer des Allemands des Blanchisseries concurrentes. Il doit faire face à la réaction de Sarah à qui il explique qu’il ne se compromet que pour parvenir à obtenir d’eux la localisation de Jean.
Dans un restaurant, Jacques et Sarah ont la malchance de rencontrer le passeur, boitillant, depuis la blessure que lui a infligé Sarah. Il les menace subtilement, et Jacques lui donne rendez-vous le lendemain pour un entretien au cours duquel ils pourront s’accorder sur le prix de son silence. Mais le jour venu, Jacques l’assassine. Les événements les rapprochent et, enfin, Sarah s’offre à lui.
L’officier Allemand avec lequel il est contact apprend à Jacques que Jean a été transféré dans un camp ‘‘dont on ne revient pas’’ car il a refusé de se ré-éduquer.
Sarah met au monde un enfant. Elle insiste auprès de Jacques pour qu’ils l’appellent Jean. Un soir, Armand explique à la famille réunie que pour le féliciter de sa conduite exemplaire ces deux dernières années, il a décidé de se retirer et de confier les affaires à Jacques. Sarah lui demande s’il est aveugle pour ignorer la manière dont Jacques a fait fleurir les affaires de la famille. ‘‘Selon les lois de la France telles que dictées par Pétain’’, réplique Armand. Sarah lui fait remarquer que De Gaule frappe à la pote et qu’il ne tardera pas à entrer.
Les faits ne tardent pas à lui donner raison. Et Jacques est arrêté pour ses nombreux actes de collaboration et son association avec d’innombrables actes de spoliation de biens Juifs. Parce qu’il a commis certains de ces actes pour sauver Jean des camps, parce qu’il a dissimulé Sarah aux Allemands, son cas est plaidable... Mais au procès, la vérité dans tout son horreur est révélée par le témoignage de Breton. C’est Jacques qui a donné Jean. C’est par sa faute qu’il a été déporté. Jacques se pend dans sa cellule.
Voyageant dans l’autre sens, des trains ramènent en France des déportés. La Croix Rouge appelle. On a retrouvé Jean. Elle se précipite aussitôt à son chevet, mais il ne semble pas la reconnaître. Un médecin lui apprend qu’il est condamné à court terme. Après de nombreuses expériences tels qu’injection d’hormones, les Allemands l’ont finalement lobotomisé...
Sarah demande à ce qu’au moins, il meure chez lui et elle est sa mère prennent soin de lui pendant ses derniers jours. A la fin, son père se rapproche enfin de lui, et partage avec sa femme et Sarah la douleur de la mort de son fils.
Mémorial de la déportation, de nos jours.
Sarah vient avec son fils et ses deux petits enfants honorer la mémoire de Jean. Mais avec les représentants des associations homosexuelles, on lui demande d’attendre la fin de la cérémonie officielle et le départ des personnalités avant qu’ils puissent organiser leur propre cérémonie dans l’indifférence. L’accès çà la crypte leur est même refusé en ce jour.
‘‘Vous pouvez m’empêcher de passer, mais vous ne pouvez pas m’empêcher de me souvenir,’’ dit Sarah...
« En France, il a fallu attendre 2001 pour que la déportation homosexuelle soit officiellement reconnue par l’Etat.
Et pourtant dès l’arrivée des Nazis au pouvoir en Allemagne en 1933 la déportation des homosexuels a commencé et s’est étendue ensuite aux pays occupés ou annexés...
Selon l’United States Holocaust Memorial de Washington, 90 000 à 100 000 homosexuels ont été arrêtés entre 1933 et 1945.
10 000 à 15 000 d’entre eux ont péri dans les camps.
En France, la loi criminalisant l’homosexualité promulguée en 1942 sous Vichy a été maintenue à la Libération.
Elle a été abrogée en 1981. »
Quoi qu’il advienne, ce téléfilm était destiné à être un événement. Car si la scène finale a pu paraître outrageante à certains, elle est pourtant très fidèle à la réalité des cérémonies de commémoration de la déportation. Elle se situe même un cran en dessous de la réalité de certaines villes ou ce sont des cordons de CRS qui empêchent les représentants des homosexuels d’approcher la cérémonie officielle, tandis que les insultes fusent. A Paris, la situation s’est détendue depuis quelques années, mais le chœur Mélo-men, vu dans le film, entame toujours son tour de chant après le départ de certains officiels. La question de la déportation des homosexuels était placée sous une chape de plomb, jamais évoquée.
Certains parmi le public ont donc eu des doutes fasse à cette scène de conclusion. De quoi alimenter des cours de scénario sur le rapport entre le vrai et le vraisemblable. La confrontation de la réalité d’aujourd’hui avec celle d’il y a cinquante ans semble obscène. C’est la meilleure preuve possible qu’ « Un Amour à Taire » a parfaitement su remplir son objectif. Profitons-en pour évacuer la question historique. Il est vrai que le contraire n’aurait pas été pardonnable, mais on doit néanmoins féliciter scénaristes et réalisateur pour leur souci de la vérité historique. Le sujet est infiniment délicat et il aurait été indécent de montrer des ‘rafles’ d’homosexuels Français. Barrette bleue contre triangle rose, la situation est même particulièrement bien expliquée.
De ce fait, la mise en place d’un contexte, d’une situation particulière précédent et provoquant la déportation était totalement indispensable. Elle est faite lors de la première partie du film avec la mise en place de cette famille et de la Blanchisserie, théâtre de la tragédie qui ne tardera pas à frapper. Il serait par ailleurs erroné de prétendre que cette première demi-heure a quelque chose à voir avec le tout venant de la production télévisuelle Française. Rarement, en effet, voit-on une écriture aussi rythmée et aussi fine. Jamais le récit ne s’appesantit, les séquences s’enchaînant rapidement, brossant par petites touches un portrait juste de Paris pendant la guerre. Celui d’une France repliée sur elle-même face à l’horreur de la solution finale. De la résignation teintée de Pétainisme du père Lavandier qui exclut bientôt les Juifs de sa boutique, à la collaboration intéressée de Jacques, sans parler de l’allégeance ignoble de Breton, le tableau dressé est peu glorieux. C’est bien une force du film, non une faiblesse, que de mettre en avant diverses formes de discriminations pendant cette période et de ne pas se centrer exclusivement sur la question gay. Parce que, bien évidemment, une horreur n’efface pas l’autre. Et parce que, à fortiori à l’époque, c’est une idiotie de couper les homosexuels du monde environnant.
En outre, on ne peut pas occulter les objectifs, pour une fois louables, de ce programme de prime-time de la deuxième chaîne de France : faire découvrir au plus grand nombre un point d’histoire méconnu, et non s’adresser à une sorte de happy fews déjà sensibilisés. Dès lors, il est nécessaire de faire connaître les personnages afin de créer les conditions de l’empathie. Le tableau de famille proposé est riche ; aucun personnage, même pas ceux des parents qui bénéficient pourtant d’un temps d’antenne limité, n’est terne ou unidimensionnel. A cet égard, Un Amour à Taire bénéficie d’une distribution véritablement irréprochable. Les prix décrochés par Louise Monnot et Nicolas Gob (Sarah et Jacques) ne sauraient faire oublier les performances de Michel Jonasz, Charlotte de Turckheim, ou Olivier Saladin dans quelques fantastiques contre-emplois. Et puis il y a bien sûr Jérémie Rénier, parfait, qui porte l’essentiel du film sur ses épaules.
Je vais quand même noter quelque chose qui m’a gêné à deux ou trois reprises dans le film. Sans rien enlever à la justesse de son jeu d’acteur, Nicolas Gob a une fâcheuse tendance à ne pas regarder ses partenaires dans les yeux quand il joue ! Je ne sais pas si c’était fait exprès ou si l’ambiance était trop bonne sur le tournage, et qu’il cherchait à éviter quelques fous rires, mais le résultat est quelques plans où les lignes de regard sont étranges.
Enfin, dans une fiction Française obnubilée par la peur de perdre des points d’audience en traumatisant la pauvre ménagère, on terminera en saluant le tragique assumé de l’histoire. Tout est dit une fois qu’on a signalé que la seule concession des scénaristes au happy end est de faire assassiner Philippe pendant que Jean est toujours dans les camps...
D’ailleurs, « Un Amour à Taire » est la preuve qu’il n’existe pas de problème en France pour innover sur le format téléfilm, ce qui condamne les lignes éditoriales qui veulent promouvoir l’innovation en se circonscrivant à l’unnitaire à l’échec. C’est dans la fiction sérialisée, celle qui est la plus adaptée au média télévision qu’il faut injecter des doses massives d’originalité, d’ambition et de situationsdécoiffantes. France 2 en est encore loin...
Cinq ans après « Juste une question d’amour », Christian Faure signe donc un nouveau film marquant, lui aussi amené a connaître de multiples diffusions associatives dans les années venir. Usant des mêmes outils : un scénario d’une grande justesse et précision signé Pascal Fontanille et Samantha Mazeras, des personnages forts et multidimensionnels, et une interprétation sans failles, il offre une nouvelle occasion à France 2 de nous prouver qu’elle peut être la chaîne du développement d’une fiction Française qui parle de quelque chose - et qui le fait bien.
Post Scriptum
France 2 - Merlin productions. Avril 2005
Scénario : Pascal Fontanille et Samantha Mazeras
Réalisation : Christian Faure
Avec : Jérémie Rénier, Louise Monot, Bruno Todeschini, Michel Jonasz, Charlotte de Turkheim et Nicolas Gob.
Dernière mise à jour
le 31 mars 2012 à 08h25
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français