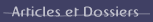La représentation de l’homosexualité dans la fiction est passée, en France, par la diffusion de fiction étrangère. Plus particulièrement, bien sûr, de fiction américaine. Ce qui, à bien y réfléchir, n’est pas un petit paradoxe. La France qui se moque si souvent du puritanisme bigot des américains, quand elle ne se pose pas en donneuse de leçons, avait, dans la réalité, fuit à grandes enjambées plutôt que de traiter ce sujet.
Un contexte très particulier
Dans les faits, si la société américaine rend effectivement plus délicat qu’en France l’abord des questions de sexualités, elle ne souffre pas par ailleurs d’un concept idéologique tel que celui de Communauté de la République qui, dernière l’idéal d’une communauté nationale unitaire, solidaire et soudée, cache en réalité un moyen facile et infaillible de nier à toute minorité politique (par opposition aux minorités folkloriques) le droit d’exister. La France se construisit ainsi une télévision des plus normée, exclusivement blanche, chrétienne et hétérosexuelle.
En France, à la fin de la décennie 90, il n’existe pratiquement aucun exemple d’homosexuel de fiction, si ce n’est peut-être une ou deux victimes de fiction policière. Le sujet, comme toute les « questions de société » est cloisonné aux talk-shows de témoignages voyeuristes et misérabilistes. On pourra tout juste noter l’existence d’un précurseur qui fait figure d’étrange exception, puisqu’il concerne le personnage de Roméo Sarfati dans la suite de mini-séries de TF1 « Une Famille Formidable », qui fit un coming-out solitaire dans la seconde moitié des années 90. A l’époque, il est la seule présence homosexuelle récurrente de la fiction française (à moins de faire état de ‘personnages’ de sitcoms AB Productions que par mansuétude, on préférera de fait oublier et qui, de toute façon, n’ont jamais été explicitement désignés comme tels).
Parallèlement, aux États-Unis, le mouvement vers une représentation équilibrée des homosexuels, parmi les autres minorités, au sein de la fiction s’est engagé dès la fin des années 70, avant de connaître une explosion quantitative et qualitative à partir du milieu des années 90. (Sur ce sujet, je vous renvois à l’article sur la représentation de l’homosexualité dans la fiction télévisée que j’ai signé pour le site du FLT en juin 2005 : première partie et seconde partie.)
Unitaires ou séries
Au-delà des différences politico-culturelles entre les deux sociétés, d’autres, liées aux structures de la fiction française, expliquent cette situation particulière. Aux USA, la série s’est très vite imposée, dès les années 50, comme le format dominant de la fiction. En France, après que quelques merveilleuses téléfictions sérielles aient été produites dans les années 60 et 70, celles-ci se sont rapidement ensuite vues dévalorisées. La série était accusée d’être une forme de fiction soumises aux règles de l’industrie, et donc du grand capital. On lui reprochait donc d’être un terrain où l’innovation et l’audace étaient impossibles, au profit de formules immuables et répétitives. Le mode d’expression de la fiction française se centra sur le téléfilm unitaire, au mieux la collection de téléfilms à héros récurrent mais immuable. La fiction télévisée française s’est muée en un sous-cinéma pour « auteurs » frustrés de grand écran, manifestant plus souvent qu’à leur tour un mépris certain pour le média qui les employait.
Il faut ne faut pourtant que peu d’objectivité pour constater qu’entre le mode français et l’américain, l’audace ne se trouvait pas exactement là où on aurait voulu qu’elle soit.
A bien y réfléchir, c’est parfaitement logique, une fois qu’on a mis de coté les clichés sur le réalisateur-auteur qui porte à l’écran sa vision, forcément bouleversifiante, en les ramenant à ce qu’ils sont - des clichés qui n’entretiennent aucun rapport de réalité avec la manière dont la télévision fonctionne, en France comme partout ailleurs.
Imaginons en effet que vous abordiez un sujet un peu difficile, qui puisse légèrement incommoder tel ou tel téléspectateur. Il est évident que si vous le faites au sein d’un unitaire, et donc d’une histoire et de personnages qui lui sont étrangers, rien ne le retient de changer de chaîne. Le même sujet traité de la même façon avec des personnages avec lequel le même téléspectateur a l’habitude d’avoir rendez-vous, qu’il affectionne et pour lesquels il a développé de l’empathie, il y a toute les chances qu’il reste jusqu’au bout, à moins que vous ne soyez carrément offensant. Dès lors, à l’instant où l’on entre dans un système où il y a concurrence entre plusieurs chaînes qui se partagent le public - sans même parler de la concurrence pour la vente d’espace publicitaires - l’unitaire n’est plus un terrain propice à proposer un contenu un tant soit peu dérangeant, tout simplement parce que c’est trop risqué pour le diffuseur. Dès lors, la seule raison de le produire, d’un point de vue gestionnaire et économique, est la retombée en matière d’image d’une oeuvre au contenu fort. Or, ce n’est pas exactement depuis hier que nous sommes en France entré dans un tel système concurrentiel, ce qui explique que la téléfiction des presque 30 dernières années n’est connu qu’un nombre minimal d’oeuvres marquantes.
Toutes les fées
Puisque la France était enfermée dans son mépris des séries, réduites au statut de sous-genre juste bon à boucher les trous de la grille en remplissant les quotas de production d’oeuvres, il a donc fallu à chaque fois des circonstances exceptionnelles et une volonté éditoriale forte pour créer des projets audacieux. Le système français empêchait l’innovation de naître d’elle-même. Il fallait systématiquement, pour qu’elle survive, que toutes les fées, diffuseur téméraire, producteur volontaires, créatifs impliqués, se penchent en même temps sur son berceau. Dans ces conditions, le principe d’inertie était à son niveau maximum et seule une poignée d’oeuvres pouvaient espérer sortir du lot chaque année.
Sur le terrain de la représentation de l’homosexualité, ce fut, comme souvent, France 2 qui eut la volonté politique de produire une oeuvre qui se démarque. Dans la deuxième moitié des années 90, la chaîne publique lance un appel d’offre pour des unitaires sentimentaux pour sa case du mercredi soir. Martine Chicot, de Hamster Productions, est en mesure de produire une telle collection. Au milieu des projets qui émergent des contacts avec les scénaristes avec lesquels elle a l’habitude de travailler, une histoire d’amour entre garçons. Elle décide de foncer et propose le sujet à la chaîne, qui l’accepte et le produits sans résistances.
« Juste une question d’amour... » est diffusé le 26 janvier 2000. Le téléfilm aborde les thèmes classiques du coming-out, de l’homophobie, et de l’acceptation, à la fois sous l’angle ‘acceptation de soit même’ et sous celui de l’acceptation de son enfant ‘‘différent’’. France 2 est bien dans la logique d’un coup qui fait du bien à l’image, quitte à ce que l’audience en souffre pour un soir : le cahier des charges officieux livré à Christian Faure, le réalisateur, lui recommande en effet de livrer en quelque sorte un film « définitif » puisqu’il n’est pas vraiment question de « revenir sur le sujet ».
La donne sera changée par l’assez incroyable succès du téléfilm. Parce qu’il est remarquablement bien conçu et équilibré, il a en effet la particularité de pouvoir toucher aussi bien les gays que la ménagère « standard ». Le soir de sa diffusion, il rassemble 6 millions de téléspectateurs devant leur écran. Surtout, et contrairement à la plupart des films de télévision, il ne sombre pas dans l’oubli du jour au lendemain. Pendant des mois, la chaîne et l’excellente distribution du film (Cyrille Thouvenin, Stephan Guerin-Tillié et Eva Darlan) sont submergés de courriers. Une rediffusion rapide sur Festival (l’ancêtre de France 4) ne suffisant pas à combler les attentes de gens qui réclament une édition vidéo, ce pari est tenté. C’est à l’époque exceptionnel pour un unitaire de télévision. Les ventes seront tout aussi exceptionnelles que l’initiative, et prolongeront encore de plusieurs mois la réception de courrier des spectateurs du film...
Ce succès change la donne, parce que l’homosexualité à l’écran perd avec lui une bonne part du facteur ’’sulfureux’’ qu’on lui attribuait.
Deux ans après « Juste une question d’amour... », M6 livre sa version sur le même thème en mars 2002 : « A cause d’un garçon » (qui portait initialement le joli titre de « Tu verras, ça te passera »). Le téléfilm est lui aussi destiné à la case familiale de l’époque le mercredi soir, dans la collection d’assez bonne qualité ‘‘Carnets d’Ados’’. Il remportera un succès similaire : bonnes audiences, édition en DVD à succès, quoiqu’à moindre échelle. Le film, qui avait le double inconvénient d’être arrivé en second et d’être un peu moins bon que celui de France 2, tendra donc pour sa part à être peu à peu oublié.
Engagement et militance
Reste que jusque là, ces projets se sont concentrées sur des projets très personnels (la part d’auto-biographie dans les scénarios est dans les deux cas très importante). Sans rien retirer à leurs qualités, il faut reconnaître qu’ils font peu ou pas de place au débat et aux grands enjeux de l’homosexualité en France au 21ème siècle. Le débat, autre grand tabou de la fiction hexagonale.
Pierre Pauquet, le scénariste de « Juste une question d’amour... » explique lui-même que, bien qu’il ait longtemps été militant des droits des gay, son scénario était dénué de volonté revendicatrice, de « message ». Même si son film a, au final, joué un rôle non négligeable dans une évolution des mentalités en cours à l’époque et qu’il est venu, ruisseau parmi d’autres, nourrir et amplifier.
De plus, si ni « Juste une question d’amour... » ni « A cause d’un garçon » ne sont des films militants, l’un et l’autre sont clairement des productions engagées, qui ont suscité et profité de l’implication très au-dessus de la normale de ceux qui ont travaillés dessus. La volonté des deux acteurs Cyrille Thouvenin et Stephan Guerin Tillié de concrétiser une égalité de traitement visuel entre couple homo et hétéro est pour beaucoup dans l’ambiance qui se dégage de leur film terminé.
On notera d’ailleurs que « Juste une question d’amour », comme « A cause d’un garçon », se terminent sur des happy-ends résolus. C’est tout juste si les deux films n’usent pas d’un carton final « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». Mais ce qui est parfois un usage français agaçant, c’est-à-dire plaquer une fin heureuse sur un film qui ne l’appelait pas forcément, sous prétexte qu’il serait interdit à la fiction télévisée de prendre ses spectateurs à rebrousse-poil, se justifie plutôt ici par une véritable volonté artistique. Il s’agit en effet de s’opposer aux clichés en proposant la vision d’un amour homosexuel équilibré et heureux, malgré ses difficultés propres. N’en déplaise aux esprits chagrins (aigris ?) qui n’y verront qu’irréalisme... voire volonté normative.
Séries et vieux travers
S’ils ont initié une dynamique qui a retiré l’homosexualité de la liste des sujets tabous à la télévision, ces deux unitaires ont aussi été diffusé en prélude de l’avènement, en cours depuis ces quelques dernières années, de l’ère de la série en France. Fort justement et avec efficacité, c’est la série qui a pu prendre le relais, développer et approfondir les thèmes abordés par ces deux films. Par exemple, en suivant l’évolution de la relation de couple, Pacs inclus, du fils Zelder dans « Avocats & Associés », sans parler de « Clara Sheller ».
Pour autant, les habitudes perdurent, et s’il s’agit de pousser le sujet plus loin, d’aborder les grands débats, on a encore souvent recours à la production d’unitaires-alibis, arbres censés cacher les forêts de téléfictions françaises désincarnées. D’ailleurs, en 2006, la mode était à l’unitaire d’histoire contemporaine, du « Rainbow Warrior » au formidable « Procès de Bobigny ».
Si le carton final traditionnel et sa suggestion de parentalité à venir n’avait pas été osé dans les deux unitaires emblématiques évoqués plus haut, d’enfants il en sera ainsi bientôt question dans un unitaire encore plus courageux de France 2, cette fois centré sur un sujet de débats : « Tous les papas ne font pas pipi debout », qui évoque deux lesbiennes mères d’un enfant. Le film fera s’hérisser bruyamment quelques associations « familiales » conservatrices, mais sera lui aussi en quelque sorte légitimé par le succès d’audience à la diffusion et une édition vidéo qui viendra ancrer la mode des éditeurs spécialisés dans la fiction gay et des rayons dédiés chez les revendeurs.
De même, cinq ans après, Christian Faure, le réalisateur de « Juste une question d’amour... » retrouve finalement « le sujet » sous un angle particulièrement polémique avec « Un amour à taire ». Cette histoire somme toute classique d’amour homosexuel a en effet la particularité de se dérouler pendant la seconde guerre mondiale. L’un des amants sera déporté dans les camps en partie à cause de son homosexualité et en reviendra lobotomisé pour avoir refusé de ‘‘guérir’’. L’objectif militant, cette fois appuyé, étant différent, la seule ‘concession’ de l’histoire au happy-end sera ici de ne pas laisser l’autre amant, résistant, le voir revenir ainsi : il a été tué avant par les Nazis. On est clairement loin des fictions à héros-citoyens tartinées de guimauve positiviste.
La déportation des homosexuels a très longtemps été officiellement niée et, l’année de la diffusion du film, de nombreuses villes refusaient encore d’associer les associations homosexuelles aux cérémonies du souvenir du 8 mai. Très forte, la conclusion d’ « Un amour à taire » met d’ailleurs les pieds dans le plat quant à ces polémiques, montrant, après le récit de l’histoire passé, l’accueil réservé à ceux qui entretiennent la mémoire de ces déportés longtemps indésirables. D’ailleurs, la séquence devait initialement se tourner dans la crypte du Mémorial de l’Ile Saint Louis, mais l’équipe n’obtint pas les autorisations de tournage du fait de son sujet... Difficile d’imaginer plus éloquente démonstration de la gêne que pouvait provoquer cette thématique...
Au terme de ce petit bilan, on constate que tous les téléfilms abordant la question gay ont rencontré le succès - ce qui est loin d’être le cas de toutes les fiction engagées, voir le sort de « Rastignac » ou d’autres fictions politiques. Ce qui prouve au passage que l’aspect sulfureux de l’homosexualité dans la France de ces 10 dernières années était plus une préconception erronée qu’une réalité, au moins quand il est question de l’homosexualité d’un « autre » de l’autre coté de l’écran.
La frilosité de la fiction française, qui s’époumone de superlatifs face à un « Clara Sheller » dont les Anglais ont produit des versions au moins dix fois plus corsées dix ou quinze ans plus tôt, n’en apparaît que plus flagrante. Et l’on ressent les décideurs des chaînes - et avec eux les publicitaires - comme enfermés dans une tour d’ivoire. Isolés d’une société en mouvement depuis longtemps, et qui n’attend rien d’autre que de voir sa réalité traduite à l’écran dans un emballage fictif attirant.
Le succès de « Plus belle la vie », avec ses couples homos qui veulent des enfants, ses aventures sur le terrain de la fiction politique, ses personnages porteurs d’opinion, ou encore ses immigrés en situation régulière ou non, ne signifie rien d’autre. Quand est-ce qu’on oublie l’idéologie au profit du pragmatisme, et qu’on passe à la vitesse supérieure en prime ou en seconde partie de soirée ?
Dernière mise à jour
le 18 février 2011 à 01h58
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- DOCTOR WHO — 6x01 : The Impossible Astronaut (L’Impossible Astronaute 1)
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
Dans la même rubrique
- POLÉMIQUE — Après « Inquisitio », France et fiction : le divorce
- DOCTOR WHO — ‘‘Let’s do it !’’ / ‘‘I can’t do it !’’ : anatomie d’une collaboration galloise
- FOCUS — La fiction télé française et la politique
- PRODUCTION — Les budgets trop lissés font-ils des séries lisses ?
- RÉGULATION — Et tranquillement, le CSA proposa de tuer la fiction française...