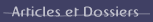Et si ce qui manquait à la fiction française, c’était un Josh Schwartz ?
Par Nicolas Robert.
La réflexion m’a frappé dimanche soir, alors que je finissais mon visionnage de la saison 4 de « Chuck », diffusée sur NT1. En France, le rapport qui unit un téléspectateur et ses fictions est rarement ludique, et c’est un vrai problème.
Comment j’en suis arrivé à ce constat ? En m’apercevant que, bien que de facture plutôt classique, avec des schémas d’épisodes parfois sur-utilisés, la série américaine produite par Josh Schwartz et Chris Fedak est parvenue à me surprendre. Tout ça grâce à un twist amené subtilement dans les derniers épisodes.
Il n’y avait là rien de fondamentalement audacieux, rien qui mérite un Golden Globe, un Emmy ou un Peabody Award. Mais les scénaristes ont réussi à tenir la promesse de divertir leur audience avec des personnages attachants et une habile utilisation des codes de la série (en gros, pour ceux qui ne connaissent pas : mixer les références la culture geek avec ceux du récit qui met en scène des espions, tout en ajoutant une touche de comédie romantique par dessus).
C’est là que ça m’a frappé : j’ai rarement entendu, lu ou vu un producteur, un scénariste ou un directeur de la fiction française dire “On a voulu proposer un vrai moment de divertissement au public, sans le prendre pour un imbécile”.
Des responsables qui disent “On a fait une comédie familiale”, “C’est une série de société” ou encore “C’est une fiction dramatique poignante”, on en a en revanche un paquet.
Sont-ils écrasés par un cahier des charges démentiel ? Possible. Sont-ils confrontés au cruel manque de culture sérielle dont souffre notre pays ? Probable.
Parce qu’au fond, le problème est là. Si le modèle français est en difficulté en 2012, c’est en partie parce que la logique profonde du récit télé, de la culture qu’il sous-tend, n’est toujours pas comprise. Pire : elle semble parfois méprisée. Et ça m’agace. Beaucoup.
J’ai un exemple pour illustrer ça, d’ailleurs. Lors du dernier festival Séries Mania, j’ai assisté à la projection de « Caïn », que l’on verra dans quelques mois sur France 2. L’histoire d’un flic anti-conformiste, misanthrope, coincé dans un fauteuil roulant et qui résout toutes sortes d’enquêtes. Vous pensez à « House » ? Moi aussi. Ma voisine aussi. L’animatrice du débat qui a suivi y a pensé également. Même les fauteuils ont dû se le dire (oh, je m’énerve…).
Pourtant, la production, après la projection, nous a dit “Non. On est parti sur l’idée de proposer quelque chose qui rappellerait « L’Homme de fer »”. Pourquoi pas, après tout. Mais pourquoi ne pas jouer avec la culture des téléspectateurs français ? Pourquoi ne pas créer de relation de connivence avec lui ? C’est un peu comme l’équipe de la série française « Le Chasseur », qui, il y a quelques années, jurait que non, leur projet de fiction sur un serial killer à la solde de sa propre mère n’avait rien à voir avec « Dexter »… (Là, je lève les yeux au ciel. Comme c’est très visuel, je précise).
La connivence, c’est le mot clef. Je sais que dans certains milieux, c’est mal. Mais à la télé, dans le cadre d’une relation téléspectateur/fiction, c’est une bonne chose. Il faut jouer avec ça, de façon subtile mais pas trop elliptique. En gros, il faut savoir trouver le truc qui se situe entre le violent coup de coude dans les côtes (too much) et le clin d’œil fait de dos (too much dans l’autre sens)…
Cette connivence, elle joue à plein dans « Chuck ». Comme elle joue à plein dans « Gossip Girl », « Hart of Dixie » ou « The OC », les autres productions de Josh Schwartz.

- Chuck
- Promo de la saison finale
En France, on ne sait pas le faire. Souvent, on ne veut pas le faire. Et cette volonté de refuser de partager un héritage commun d’images, d’histoires, de sons et de références, ça m’agace (On sent que je m’énerve bien comme il faut, là ?).
Ça m’horripile d’autant plus que cette absence de connivence ne se retrouve pas seulement dans le partage d’un vécu, il contamine maladroitement le partage d’un possible.
En clair : avec « Caïn », on se retrouve face à une série qui possède un bon premier rôle, quelques lignes de dialogues savoureuses… mais une exposition bancale dans le premier épisode. Après la projection, la production a précisé qu’au fil des épisodes, on va mieux saisir la complexité du héros. Vrai : quelques éléments sont déjà esquissés dans le numéro deux. Mais personnellement, je refuse d’attendre l’épisode 6 pour me dire “Ah oui, finalement c’est bien”. Je veux trouver des éléments qui me suggère tout un éventail de possibilités dès le pilote (Ayé : je suis énervé).
Ici, ce n’est pas vraiment le cas. Dans celui de « Chuck », ça l’est. Comme dans toutes les séries de Josh Schwartz. Ce dernier n’aura sans doute jamais l’aura d’un David Simon ou d’un Shawn Ryan, des auteurs que l’on adore citer en exemple de ce qu’on voudrait parfois faire en France. Mais son savoir-faire est incontestable, qu’on aime ou non les polygones amoureux.
Schwartz est-il un producteur moins ambitieux qu’eux ? Peut-être. Ou alors il a peut-être envie de proposer des séries bien faites, qui sont avant tout divertissantes et auxquelles une large audience peut s’accrocher. Un truc simple, efficace et très attachant.
J’attends donc notre Josh Schwartz. Impatiemment. Un gars ou une fille qui produira des fictions avec des épisodes faciles et d’autres vraiment bien fichus. Un mec ou une nana qui a envie de partager un truc certes simple mais sincère avec des téléspectateurs, et que l’on laissera faire.
Un monsieur ou une dame qui produira une série française dont le rédacteur en chef du village pourra dire, via Twitter, “Franchement, cette cinquième saison, c’est n’importe quoi” [1], mais que sans doute, il regardera quand même.
Oui, vivement notre Josh Schwartz.
Se redonner l’envie d’avoir envie
Par Sullivan Le Postec.
Le billet très juste de Nicolas, que vous venez de lire, m’a directement renvoyé à un autre tout aussi juste, publié il y a quelques jours par Ladyteruki sur son blog Ladytelephagy.
Elle y évoquait ses difficultés à découvrir avec enthousiasme la fiction télé française, en faisant le constat du désarmant manque d’enthousiasme que celle-ci dégageait au départ. Depuis plus de cinq ans que nous sommes entrés pleinement dans la crise (celle des audiences ayant finalement entériné la crise créative que d’aucuns on fait semblant de ne pas voir jusqu’à ce qu’il soit trop tard), la fiction française est effectivement essentiellement évoquée sous l’angle du ‘‘douloureux problème’’.
Dans ce billet, Ladyteruki pointait le fait que les britanniques, qu’on érige souvent en modèle ici-même, ne sont pas les derniers pour s’auto-flageller et noircir des centaines de pages de journaux et de billets de blogs sur la soi-disant infériorité de leurs séries. ‘‘Donc ils complexent sur leur fiction ; pendant ce temps, nous on complexe sur la nôtre... Et on n’en finit pas se dévaloriser les uns par rapport aux autres, quel chaîne de négativité, c’est incroyable !’’ écrivait-elle.
Il y a beaucoup de vrai dans ce constat. Le plaisir, la connivence ludique, sont absents de la communication autour des séries françaises, comme le fait remarquer Ladyteruki... parce qu’ils sont la plupart du temps absents de ce que nous diffusons, comme vient de le mentionner Nicolas.
J’ajouterai qu’il faut surement remonter d’un cran : tout cela découle probablement du fait que le plaisir est très peu présent en coulisse, chez ceux qui écrivent, réalisent, et jouent dans nos séries. C’est un des héritages de notre système : notre télévision est une industrie de la frustration, de la castration de la créativité.
Sans surprise, quand on retourne le problème, on aura tôt fait de remarquer que des aventures de production heureuses ont bien souvent mené à des réussites, au moins artistiques. Difficile de ne pas voir comment le plaisir sincère pris à réinventer le feuilleton et à élaborer des intrigues aussi fortes qu’abracadabrantesques a transformé « Plus Belle la Vie » de bide à plus gros succès de France 3.
On repense aussi à l’enthousiasme communicatif, au moins au début de la série, des comédiens des « Bleus » pour leurs légères aventures, du bouillonnement créatif qui pousse « Un Village Français » à se remettre toujours en question, de l’envie d’un Olivier Kohn d’étendre encore un peu plus loin le champ de ses connaissances sur les rouages du monde pour en infuser « Reporters », de l’appétit glouton des deux H (Hadmar et Herpoux) pour la mythologie parisienne de « Pigalle », ou de la tendresse non feinte de Virginie Brac et Gilles Bannier pour leurs « Beaux Mecs »...
A côté de cela, il y a la majorité des séries françaises, et leurs histoires plus ou moins publiques de coulisses tourmentées, de bras de fer tendus, de créatifs désillusionnés. Évidemment, que cela finit par se voir à l’écran ! Comment pourrait-il en être autrement ?
Est-ce que l’on peut encore être heureux en faisant de la fiction pour la télévision française ? Aussi niaise soit-elle, la question est vraisemblablement cruciale.
Enfant de Canal
Par Dominique Montay.
C’est certainement une erreur et je m’en veux un peu ces derniers temps, mais aucun projet de Canal+ en terme de création originale ne me donne envie d’aller y jeter un œil. Ces derniers mois ont été tellement chargés de déceptions que la prochaine série ou saison Canal, je me présenterais devant à reculons.
Ce qui, maintenant que je relis la phrase, peut s’avérer être très compliqué. A moins d’avoir un rétroviseur.
Plus sérieusement, je suis un enfant de Canal. Pourquoi j’en parle maintenant et pas pendant ma cure de « Borgia » ? Ou mon « oubli » de « Kaboul Kitchen » (non, je ne l’ai pas regardée, booooo, vous pouvez me balancer des patates) ? Parce que Cannes arrive. Et Cannes = souvenirs sur Canal. « Nulle Part Ailleurs » y allait en son temps et proposait certainement ses quinze jours les plus mauvais. Et ça me fascinait, à l’époque. Les interviews duraient trois secondes, personne ne pouvait en placer une à cause du public qui gueulait, et souvent il y avait du vent.
Et pourtant j’étais à fond dedans, sans le recul qui me permet de dire aujourd’hui que c’était nul. Le reste de l’année, « NPA » était la Rolls du talk-show. Mais certainement pas à Cannes, dont les souvenirs sont pourtant les plus vivaces aujourd’hui, et ravivent ma nostalgie de Canal.
Je suis un enfant de Canal+.
J’avais scopée la nuit des 10 ans, et usé les cassettes. J’ai regardé « NPA » bien après sa date de péremption. Je vénère encore aujourd’hui les sketches des Nuls, même si je sais maintenant qu’il ont pompé les trois quarts de leurs sketches au « Saturday Night Live ». Je forçais même mes parents à mettre la rediff des « Nuls l’Émission » le dimanche après midi après le repas de famille, devant les yeux réprobateurs de ma chère grand-mère, et ses “rhooo” continuels.
J’aimais encore Canal+ après ça. Quand la chaîne s’est lancée dans les créations originales, passée la grosse déception « Engrenages » Saison 1, et le « mais... pourquoi faire ? » que m’inspira « Le Bureau », je me suis pris successivement « Reporters » et la saison 2 d’« Engrenages », et la baffe « Pigalle, la nuit » en pleine tronche.
Hélas, depuis, la politique fiction de la chaîne ne prend pas le chemin que j’aurais aimé qu’elle prenne. En annulant « Pigalle, la nuit », « Reporters », en montant des projets qui ne me plaisent pas ou pire, m’indiffèrent (« Working Girls »).
Je ne regrette pas la « période dorée » de Canal, l’époque DeCaunes/Les Nuls... J’aimerais juste qu’elle prenne un autre chemin que celui qu’elle emprunte (Denisot/« Braquo »), qu’il soit, très égoïstement, plus proche du mien, elle qui m’a si longtemps accompagnée.
Maintenant, je viens de dire le mot qu’il faut. Egoïste. Oui, Canal, j’aimerais que tu sois la chaine que j’ai envie de regarder tout le temps. Tant pis si ce que tu fais, en terme d’audience, fonctionne. Je m’en fous. L’amour, même entre un sériphile téléphage et une chaîne, ça n’est pas rationnel.
J’assume.
Dernière mise à jour
le 14 mai 2012 à 23h41
Articles par Dominique Montay
Articles par Nicolas Robert
Articles par Sullivan Le Postec
- Le dernier édito : retour sur Le Village
- G. BANNIER & C. DE BOURBON BUSSET — ‘‘Les Beaux Mecs ? Une aventure humaine et artistique unique’’
- LES VISAGES DES BEAUX MECS — Episode 1 : Kenz et La Gazette
- CA TOURNE ! – La tension monte dans le Village Français
- DOCTOR WHO — An Unearthly Child (épisodes 1 à 4, 1963)
Dans la même rubrique
Notes
[1] Message perso : “En vrai, patron, « Gossip Girl », c’est pire que ça. Mais tant pis. Gros bisous. Nico.”