Accueil > Chroniques > Le Monde (Merveilleux) des Séries > T’es Mytho !
Episode 2.03
 T’es Mytho !
T’es Mytho !
dimanche 6 novembre 2005, par
Après plus d’un an d’absence, à la demande générale, et parce que ça me fait plaisir voici le retour du Dico de la LTE, Chapitre 18. Ou quelque chose de pas trop différent.
La définition (du petit Robert)
n.f. - XIV° ; bas lat. mythologia, gr. muthologie. 1- Ensemble des mythes, des légendes propre à un peuple, à une civilisation, à une religion. Mythologie hindoue, grecque - specialt. mythologie de l’Antiquité greco-romaine. Fables de la mythologie. Dieux, déesses, héros et demi-dieux de la mythologie (=> panthéon). 2 - Science, étude des mythes de leurs origines, de leur développement et de leur signification. 3 - Ensemble des mythes sse rapportant à un même objet, un même thème, une même doctrine.
Dans cette chronique je ne parlerais pas des dieux et déesses des séries. Ce qui pourrait être amusant pour une prochaine fois. Il sera bien entendu question de quelque chose pouvant se rapprocher de la troisième définition du Robert (qui n’était pas là juste pour faire du remplissage, il faut pas croire que je ne sais pas où je vais). En se rapportant à cette définition
La naissance des mythes : The X Files
C’est à partir de The X Files que l’on commence à parler de mythologie dans une série. La construction narrative alterne des épisodes isolés développant une histoire bouclées (looners) et des épisodes liés entre eux (de façon plus ou moins forte) qui constituent la mythologie de la série. Ces derniers tissent une toile sur l’ensemble des neuf saisons de la série, mêlant conspiration gouvernementale, invasion extraterrestres, enlèvements inexpliqués. Ils sont ceux qui provoquent le plus de réaction, suscite le phénomène culte, créent l’attente et la frustration. Pourtant ils ne représentent qu’une part minime de la série, une quarantaine d’épisode en neuf ans et 200 épisodes. Bien souvent leur qualité est en dessous des meilleurs looners.
Si l’on se penche sur l’histoire des séries on retrouve une situation similaire avec Le Fugitif. Beaucoup de looners, quelques épisodes avec le manchot et/ou le Lieutenant Gerard. Ce qui n’empêche pas la série d’être imprégnée fortement par cette double chasse à l’homme, l’adaptation cinématographique la condensera d’ailleurs avec beaucoup de talent.
Cas isolé dans les années 60 il est aujourd’hui impossible de produire une série sans lui donner une mythologie. Notamment pour les série de SF ou Fantastique.
Twin Peak : avant la mythologie
Parce qu’elle revêt l’apparence d’une série policière et la construction d’un soap, Twin Peaks possède une continuité narrative forte. Mais l’introduction d’élément fantastique et de références folkloriques et magiques crée une mythologie qui dépassera l’enquête sur la mort de Laura Palmer. Dans la seconde partie de la série cette dimension prendra le dessus sans pour autant être mieux traitée. Mythologie avant l’heure (The X Files n’est pas encore passé par là) elle reste un exemple de construction improvisée.
Babylon 5 : une modèle
Une bonne mythologie doit créer une attente chez le téléspectateur. Les questions posées doivent susciter l’intérêt et toute la difficulté réside dans la bonne résolution des interrogations. Il faut répondre tout en gardant une part de mystère.
Avec The X Files chaque pseudo réponse entraînait dix autres questions, ce qui à la longue fini par lasser, et laisse voir que les créateurs ne savent pas ce qu’ils font et où ils veulent aller.
Babylon 5 est le parfait contre exemple, un modèle du genre. Parfaitement maîtrise la narration jalonne la série de questions dans sa première partie et apporte les réponses dans la seconde sans que cela paraisse artificiel, mais au contraire totalement naturel. Aucune des lignes narrative ouverte n’est laissées en suspens à la fin de la série, toutes ont connu un développement et une conclusion, chaque personnage a connu une évolution quand on le laisse au bout des cinq saisons il est arrivé au bout d’un parcours, d’un cheminement, et nous le laissons aux portes d’un nouveau chapitre de son existence.
Buffy : tout en subtilité
La série de Joss Whedon est un parfait exemple de ce qui peut se faire de mieux et de plus subtil. Moins construite sur le long terme que Babylon 5, elle n’en reste pas moins une série qui possède une mythologie qui évoluera tout au long des 7 saisons de son existence.
Chaque saison construit sa propre mythologie avec son méchant dont le dernier épisode verra la défaite. Au delà de cet aspect “primaire” toutes les saisons tournent autour d’un thème, chaque personnage connaissant des évolutions, des changement plus ou moins radicaux.
A coté de ces thématiques l’ensemble de la série nous raconte le parcours de la Tueuse, mythologie transversale qui connaîtra son apothéose dans la dernière saison.
Star Trek : Deep Space Nine : De la continuité dans le Trekverse
Gene Roddenberry était allergique aux arcs et aux histoires feuilletonnantes. Star Trek : TOS et Star Trek : TNG en sont pratiquement dépourvues. Mais DS9 première série Trek crée sans lui et confiée à des mécréants géniaux se transformera en vraie série feuilleton, avec une mythologie, des arcs, et des looners.
Sans être aussi maîtrisée que Babylon 5, la mythologie n’a pas été écrite dès la création de la série mais naîtra progressivement, DS9 est de toutes les séries Trek la seule à ce jour à avoir une cohérence interne aussi poussée, avec un début, un milieu et une fin.
Stargate SG1 : Il ne suffit pas d’avoir des dieux comme personnage
Tout est dit dans le titre. Stargate SG1 utilise les mythologies égyptiennes, nordiques et autres mais n’arrive pas à mettre en place une vraie mythologie interne forte, cohérente et surtout intéressante. Les épisodes se suivent sans qu’on puisse y voir une vraie continuité. Il semble que les scénariste poussent le bouton reset à chaque fois. Les rares épisodes se rapprochant un peu d’un semblant de mythologie sont dépourvus d’enjeux puisque les téléspectateurs, pas dupe, savent que tout serra oublié la semaine suivante.
Toutes les séries évoquée jusqu’ici sont arrivées à leur terme (sauf Stargate SG1 bien sur, mais bon...) par conséquent il est facile de juger de leur mythologie dans son ensemble. Pas sur que Babylon 5 aurait droit à de tel éloge s’il n’y avait eu qu’une saison. A ce titre je ne me permettrais pas de porter le moindre avis sur Lost parce que à ce point de la série (une saison et des poussières) je ne vois pas où on veut me conduire, même si j’ai l’impression que les scénaristes ne le savent pas plus que moi.
Pour Alias les choses sont plus claires, même si la série n’est pas encore terminée (cela ne va pas tarder mais en attendant..) il est évident qu’après une parfaite maîtrise dans les premières saisons les choses sont un peu parties en vrille, ou au moins ce sont un peu égarée en chemin. Les histoires autours de Rambaldi et ses merveilleuses machines s’embrouillent quelque peu, certaines lignes semblent rester en suspens de façon définitive, et depuis la fin de la saison 4 la mythologie connaît semble-t-il un changement de direction.
Pour les nostalgiques, les fans de ma prose et ceux qui ont manqué les épisodes précédents l’intégrale du Dico de la LTE et toute la première saison de LM(M)DS sont de nouveau disponible.
 LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires
LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires
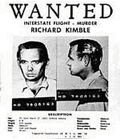
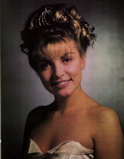

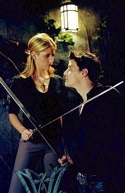


Messages
1. > T’es Mytho !, 6 novembre 2005, 16:19, par Stratego
Chouette ! :-))
2. ma définition à moi :), 6 novembre 2005, 18:35, par Guigui le gentil
Parce que pour moi le terme "mythologie" ne signifie pas uniquement "arc narratif", j’apporte ma définition perso qui est certes un peu restrictive mais plus proche de ce qu’on entendait par "mythologie" dans le cas de X-Files.
Une mythologie est un genre d’intrigue se basant sur des éléments subtilement dispatchés tout le long d’une narration (c’est très souvent de petits détails comme une bride de conversation par exemple), sur lesquels elle s’appuie afin d’en faire comprendre le récit. C’est un genre faisant très souvent appel aux flash-backs et à un enchaînement des événements éclatés sur lesquels peut revenir la narration à n’importe quel moment, pouvant les expliquer, les compléter et même les contredire afin de faire rebondir le récit. Le principal attrait d’une telle façon de raconter une histoire étant l’interactivité avec le spectateur qui n’assiste plus de façon passive à cette dernière. Le spectateur peut ainsi combler des zones d’ombres laissé volontairement (et de façon cohérente) par les scénarios. Exemple de mythologie : THE X-FILES, Evangelion, MillenniuM, NoWhere Man et... ALIAS...