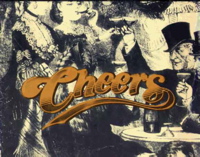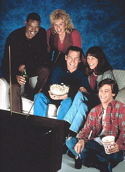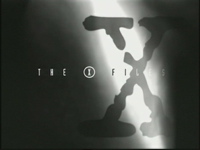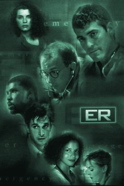Accueil > Chroniques > Le Monde (Merveilleux) des Séries > Une histoire des séries - 3° Partie : Du renouveau au second âge (...)
Episode 2.07
 Une histoire des séries - 3° Partie : Du renouveau au second âge d’or
Une histoire des séries - 3° Partie : Du renouveau au second âge d’or
jeudi 9 mars 2006, par
Continuons notre exploration de l’histoire des séries télévisées dans ce troisième volet, mais pas dernier de cette trilogie qui compte quatre épisodes (ne cherchez pas à comprendre c’est tout ce qu’il y a de plus normal). Après le passage à vide des années 70 cette fois-ci c’est du lourd, je vous en laisse juge.
Le retour de la créativité
Sous l’impulsion de Hill Street Blues et St Elsewhere la fiction télévisuelle change dans les années 80. Steven Bochco “transpose” HSB dans un cabinet d’avocat et connaît de nouveau le succès avec L.A Law.
Outre le renouvellement des têtes, des thèmes, les chaînes découvrent que l’audace paie. Les spectateurs sont prêts à être bousculés dans leurs habitudes. La concurrence grandissante entre les network pousse à l’originalité (contrairement à ce qui se produira en France)
deux séries de la fin des années 80 sont représentatives de la liberté accordée aux créateurs.
Un Flic Dans la Mafia (The Wiseguy) à l’apparence d’une série policière, mais propose une plongée dans les différents milieux du crime organisé des États Unis (trafic d’armes, jeux, show-biz....) au travers d’arc narratifs maîtrises de bout en bout. Proposant une vision sombre du monde, un héros complexe et tourmenté. The Wiseguy demande aux téléspectateurs une attention poussée. Bijou télévisuel trop peu connu de ce côté-ci de l’Atlantique The Wiseguy porte en germe les fictions noires des décennies suivantes (comme The Wire par exemple)
Dans un tout autre genre Glen Gordon Caron propose avec Clair de Lune (Moonlighting) une série qui dynamite complètement la narration télévisuelle classique. Mélangeant les genres, à la fois série policière (mais si peu), série comique, série romantique, série parodique... Moonlighting est également un hommage aux screwball comedy des années 50 dont le plus bel exemple est La Dame du Vendredi (His Girl Friday). Très écrite malgré l’impression d’improvisation et de foutraque permanent, la série vient troubler le bel ordonnancement de la fiction télévisuelle quand Bruce Willis et Cybil Sheperd s’adressent directement aux téléspectateurs, ou quand en fin de saison les techniciens enlèvent les décors avant la fin de l’épisode parce qu’ils partent en vacances.
La télé ose se moquer d’elle même et des héros qui ne sont pas exemplaires. finit les Joe Friday (Dragnet) flic psychorigide, les Mannix détectives au complet veston impecable. Magnum est aux antipodes de ces modèles des années 60 et 70. Il ne se prend pas au sérieux, préfère le surf aux enquêtes, profite de la superbe propriété de Robin Masters dont il doit assurer la sécurité, traîne au bar avec ses potes, bref il est plus un dilettante qu’un détective. il n’en reste pas moins qu’au travers du passé de Magnum la série porte un regard juste sur les anciens du Viet Nam, offre une construction narrative fidèle aux schémas traditionnels du genre privé, et se révèle très bien écrite.
Magnum permet à Donald Bellisario de se faire un nom et d’avoir plus de poids pour créer une série marquante de la fin des années 80 Code Quantum (Quantum Leap).
Basée sur un postulat de SF, le voyage dans le temps, CQ est une exploration de 50 ans d’histoire des États Unis par le duo Dean Stockwell et Scott Bakula. CQ bénéficie d’un capital sympathie énorme qui 20 ans après n’a pas faiblit.
CQ brasse les genres au fil de ses épisodes, policiers, drame, comédie musicale,... lui permettant de ne jamais se monter trop répétitifs malgré un canevas de base très basique.
Même si la base SF n’est qu’un prétexte, CQ réintroduit le genre à la télé US simultanément au retour sur les écrans d’un titre mythique du premier âge d’or : Star Trek.
En 1987 l’Enterprise refait surface 20 ans après sa disparition. Nouvel équipage, nouveau vaisseau, nouvelle époque, Star Trek : The Next Generation ne se contente pas de marcher dans les pas de son illustre aînée. Elle s’inscrit par ses thèmes dans son époque. Elle réinvente intelligemment l’univers trekien, et devient une série emblématique de la SF. Allant plus loin que la série originale (les moyens techniques lui permettant plus de liberté que dans les années 60) TNG reste une des meilleures série de SF de l’histoire de la télévision. Elle a aussi permit à la franchise de renaître, trois séries suivront l’équipage de Jean-Luc Picard pour le meilleur (Star Trek : Deep Space Nine, la perle noire de l’univers Trek) et le pire (Enterprise de sinistre mémoire)
Autre genre renaissant dans les années 80 la comédie.
Bien avant que Seinfeld, Friends et autres ne squattent la grille de NBC, Cheers était la sitcom phare de la chaîne. Pendant 11 ans le microcosme évoluant dans ce bar fit les beaux jours de NBC, et donna naissance à un spin off tout aussi populaire Fraisier. Sans révolutionner le genre dont elle reprend la mécanique, Cheers introduit tout de même un ton différent, plus libre, plus incisif.
Toutes ces séries témoignent de la vigueur du genre, le dynamisme de la production et la créativité des scénaristes au cours des années 80. Les networks ont également senti le potentiel économique des séries, et la nécessité de laisser les créateurs libres d’innover, d’oser, d’explorer. Les années 8à marquent plus que le renouveau, la révolution télévisuelle et annoncent ce qui sera dans les années 90 le second âge d’or.
Le début du second âge d’or
Au tournant des années 80 et 90, une série révolutionnaire s’installe sur ABC qui affiche sa volonté d’innover : Twin Peaks.
Le network confie à David Lynch et Mark Frost le soin de développer une série nouvelle, audacieuse, différente. Twin Peaks répond parfaitement à ces attentes et pousse très loin les limites du genre télévisuel. Reprennant les codes de différents genres (soap, policier, fantastique) elle les mêle, les détourne, les étire, les transforme pour donne naissance à une fiction déroutante, envoûtante, et avant tout passionnante. De courte durée, mais marquante, Twin Peaks n’influence pas vraiment d’autres productions, mais dit que tout est possible à la télévision (ou presque).
L’autre grande innovation télévisuelle du début des années 90 vient d’une chaîne qui jusqu’alors était absente du monde des séries : HBO.
Dream On, première série de la chaîne à péage américaine, change la donne en matière de sitcom, faisant table rase des règles mises en place avec I Love Lucy. Ici plus de tournage en public avec plusieurs caméras. Tournée comme une drama, Dream On ausculte la vie sentimentale et sexuelle d’un quadra new-yorkais divorce et père d’un ado. La grande trouvaille de la série, au-delà d’un ton libre, audacieux, moderne, et de la présence de seins, est l’utilisation d’insert extrait de film ou téléfilms en noir et blanc, le plus souvent de séries B ou Z, servant à illustrer les pensées de Martin Tupper, enfant du baby-boom élevé devant (et par) son poste de télévision.
Ces deux séries si elles restent marginales (Dream On est diffusée sur HBO reste limité à un public restreint et Twin Peaks après un emballement et un phénomène de mode disparaît dans l’indifférence générale) par rapport aux autres productions sont tout de même celles qui par leur audace, leur liberté, leur innovation, ouvrent à mon sens le second âge d’or.
Les années 90 s’ouvrent sur de profonds changements dans les habitudes des téléspectateurs américains. Depuis le milieu des années 80, les magnétoscopes ont fait leur apparition dans les foyers, les trois networks historiques voient augmenter la concurrence du câble et surtout l’arrivée d’un quatrième réseau national venant marcher sur leurs platebandes, la Fox. Apparue en 1987 elle commence à devenir un sérieux concurrent en 1989 avec The Simpsons, série animée pour adulte qui se paie le luxe de battre l’indétronable Cosby Show. Mais le véritable coup de tonnerre intervient en 1994 avec The X Files.
Au départ petite série bien faite réutilisant, réinventant (avec plus ou moins de bonheur) des figures classiques du fantastique et de la SF, The X Files devint rapidement une série incontournable et addictive quant au milieu d’épisodes “anthologiques” ou looner, s’installe une trame générale dite mythologique mêlant conspiration gouvernementale, invasion extraterrestre, expériences médicales, manipulation génétique...
Succés planétaire, phénomène culturel, The X files, à défaut d’être la grande série fantastique que certains affirment, à fait des séries télés un marché économique lucratif.
Parallèlement sur NBC et ABC deux séries vont marquer le début et le reste de la décennie par leur qualité, leur originalité (toute relative) et surtout leur succès populaire.
Crée par le romancier à succès Michael Chrichton, mais véritablement développée par une équipe de scénaristes en étroite collaboration avec de vrais médecins, Urgences (ER), est l’héritière de St Elsewhre, le côté décalé en moins. Sans être révolutionnaire, elle reprend les “recettes” de HSB et St Elsewhere, ER captive par sa représentation réaliste de la médecine et des médecins. Les termes médicaux sont authentiques (et le spectateur novice ne trouve aucune traduction) les procédures supervisées par des médecins urgentistes, les cas cliniques inspirés de cas réel. Ce réalisme jusque dans les opérations chirurgicales qui ne nous épargnent pas les effusions de sang et de viscères, donne un cachet particulier à la série. Car au-delà de cette plongée quasi documentaire dans un service des urgences d’un grand hôpital, c’est dans le quotidien des médecins et des infirmières que nous rentrons. Ce réalisme dans la description de leur quotidien rend les personnages plus forts, plus palpables, plus attachants. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, pas si différent de nous, que nous voyons sur l’écran, pas des surhommes. S’ils nous sont également si proche c’est qu’ils évoluent dans un milieu que nous avons tous, ou que nous fréquenterons tous, celui de la maladie, la souffrance, et la mort.
 Steven Bochco qui avait bousculé les téléfictions avec HSB et L.A Law dans les années 80 revient à la charge avec ce qui est à ce jour sa création la plus populaire et la plus acclamée : NYPB Blue.
Steven Bochco qui avait bousculé les téléfictions avec HSB et L.A Law dans les années 80 revient à la charge avec ce qui est à ce jour sa création la plus populaire et la plus acclamée : NYPB Blue.
Toujours situé dans le milieu policier NYPD Blue ose tout ou presque : langage cru, nudité, violence, mais aussi, mais surtout, d’avoir un personnage central alcoolique, raciste, misogyne, totalement antipathique : Andy Sipowitz.
Servis par une réalisation nerveuse, des scénarii réalistes NYPD Blue devient un modèle du genre (impossilbe de ne pas y penser en regardant The Shield) et un électrochoc pour le téléspectateur.
Série ambitieuse, ton décomplexé, description sans concession du monde seront les maîtres mots des séries qui marqueront les années 90 et seront les figures emblématiques du second âge d’or de la télévision américaine.
Au même moment...
...en Angleterre.
Les années 80 sont sinistrées en Grande Bretagne. La crise économique, le thatchérisme ne sont pas motivants pour les créateurs. Tout comme le cinéma, la fiction télévisuelle anglaise est cliniquement morte.
Il faut attendre les années 90 pour voir arriver un frémissement qui se manifeste du côté des comédies. Ab Fab, The New Statesman, Father Ted et autres Bottom viennent apporter une bouffée d’air frais dans les programmes, une saine contestation, et redonnent confiances aux créateurs.
... en France.
En 1984 le P.A.F. s’enrichi d’une 4° chaine, Canal +. Puis viennent la 5 et TV6 (qui deviendra rapidement M6). En 1986 TF1 est privatisée. Alors que l’on aurait pu espérer que cette multiplication des chaînes et le bouleversement du P.A.F. aurait crée une saine émulation entre les chaînes, et le lancement de projet de fictions ambitieuses, rapidement TF1 écrase tout le monde ne audience avec des fictions formatées, aseptisée, sans intérêt. Les autres chaînes restent sonnées, ou lui emboîtent le pas. la fiction française de qualité semble morte.
Prochain épisode : Le coeur du second âge d’or et après...
 LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires
LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires