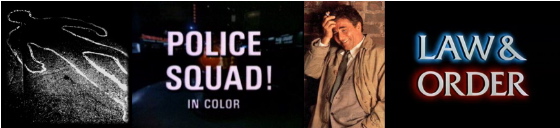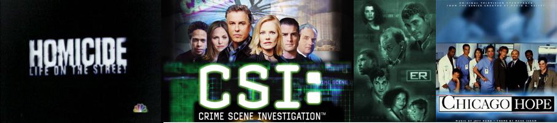Accueil > Chroniques > Le Monde (Merveilleux) des Séries > R.I.P.
Episode 1.03
 R.I.P.
R.I.P.
mercredi 17 novembre 2004, par
Pour cette chronique de novembre, mois des chrysanthème et de la fête des morts, qui je le rappelle tombe le 2, le 1° novembre c’est la fête de tous les saints, attention à ne pas confondre, donc en ce beau mois de novembre abordons ensemble un sujet qui nous touche tous. En effet il y a 5 choses, 5 lois naturelle auxquelles nous ne pouvons pas échapper.
![]() Nous avons tous un genre (masculin/féminin)
Nous avons tous un genre (masculin/féminin)
![]() Nous avons tous deux parents, deux géniteurs.
Nous avons tous deux parents, deux géniteurs.
![]() Nous avons tous un passé
Nous avons tous un passé
![]() Je ne me souviens jamais du 4
Je ne me souviens jamais du 4
![]() Nous allons tous mourir.
Nous allons tous mourir.
Je sais que ce n’est pas très gai mais autant nous préparer du mieux possible à cette inévitable conclusion en regardant des séries. Un façon de vivre heureux en attendant la mort. Un peu comme le disait Pierre Desproges.
La Mort Accessoire
Dans bon nombre de productions la mort n’est qu’un élément nécessaire à la narration. Dans les séries policières il faut un cadavre pour qu’il y est une enquête criminelle. Cet élément est un accessoire narratif, interchangeable, juste le déclencheur de l’histoire. Si dans les séries comme Columbo nous avons le droit de voir le “mort” vivant, de faire connaissance avec lui, bien souvent l’acteur qui joue ce rôle n’a pas une seule ligne de dialogue, il ne fait que de la figuration, il n’est à peine plus qu’un élément de décor, comme dans Law & order où l’épisode commence avec la découverte du corps. Une série parodique comme Police Squad ! (malheureusement en grande partie inédite en France) s’amuse de cette situation et donne dans le générique le rôle du mort à une guest star prestigieuse qui n’aura pas d’autre apparition dans le reste de l’épisode.
Il existe également une réticence à parler de la mort de façon réaliste dans certaine série. Dans Chapeau Melon et bottes de Cuir les corps, même s’ils ont subit les pires violences ne portent pas le moindre trace de sang, et les femmes ne se retrouvent jamais dans la position de la victime.
Pour cette dernière série c’est certes un choix artistique, mais il existe dans la plupart des production des années 60 une distance vis à vis de la mort, un tabou.
Il faut également noter que à cette époque les personnages principaux des séries sont immortels (sauf dans les soap où le temps s’écoule vraiment mais j’ai déjà aborder la question du temps dans une autre chronique). Les différents membres de l’IMF se succèdent sans que l’on sache ce qu’ils deviennent un fois qu’ils ne font plus partie de l’équipe de Phelps. Il est hors de question de voir mourir Cathy Gale ou emma Peel même lorsque les actrices quittent la série.
La mort qu’il faut
La mort va peu à peu prendre une place différente dans les séries. Si dans les cop-show le crime et le cadavre sont toujours essentiel à l’histoire (vous imaginez une série policière sans crime à résoudre) le mort devient plus qu’un simple accessoire, il va prendre une place plus importante. Sans voler la vedette aux enquêteurs toute fois.
Dans Homicide pour la première fois nos entrons dans la salle d’autopsie. Ce n’est qu’un petit détail mais qui a son importance. Le cadavre n’est plus un élément de décor anonyme, il a “une vie”, les enquêteurs sont là pour parler à sa place comme le dit Penbleton. C’est également dans cette série que pour la première fois le médecin légiste trouve une place au générique au même titre que les autre policiers. Cette place se retrouve également dans le processus de l’enquête. Il n’est plus juste un figurant qui vient enlever le corps une fois que le flics l’ont examiné. Si cette incursion reste limité (et assez mal exploitée) elle ouvre la voie à une exploration plus poussée du mort qu’il faut pour raconter les histoires.
Dans CSI nous ne nous contentons plus de suivre le mort jusque sur la table d’autopsie, nous assistons à celle ci, nous pénétrons dans le corps même du mort, nous découvrons que chaque mort raconte une histoire, le légiste est là pour nous aider à la déchiffrer. Le cadavre sans prendre le centre de l’histoire devient un élément narratif fort, participant activement à l’histoire. Dans cette série le corps prends une place visuellement forte, nous l’explorons, rentrons dans les chairs, les organes.
Le renouveau des séries médicales avec l’arrivée de Urgences et Chicago Hope le mort n’est plus une éventualité, une option, elle est une issue à la fois inéluctable mais aussi acceptable dans le processus narratif.
Les patients qui passent entre les mains des médecins du Cook County et du Chicago Hospital meurent aussi. Les médecins ne sont pas infaillibles. Nous ne sommes plus face à des docteurs miracles des séries médicales d’avant (pour en rajouter une couche avec St Elsewhere avait dés les début des années 80 fait évoluer les situation). Non seulement les patients meurent mais en plus les médecins aussi. Mark Greene a eu une tumeur au cerveau dont il finira par mourir à la fin de la neuvième saison. Ce n’est pas un cas isolé, dans Chicago Hope le docteur Shut fera un anévrisme cérébral le laissant incapable de pratiquer la neurochirurgie pendant plusieurs saisons.
La mort de Greene n’est pas un cas isolé, les personnages des séries moderne meurent aussi. Dans la série classique Mission : Impossible comme je l’ai dit aucun des membres de l’IMF n’est mort, dans la série 20 ans après nous assisterons à la mort de
Casey Randall (Terry Markwel). Généralement la mort d’un personnage est liée au désir de l’acteur de quitter la série. Les scénaristes ne se contentent plus de le faire disparaître mais lui écrivent une vraie sortie, qui est parfois définitive. Dans NYPD Blue Bobby Simone s’en va après une longue et douloureuse maladie et de façon mélodramatique comme l’aime les auteurs. Dans Law & Order par deux fois des personnages sont tués lors du départ des acteurs. Au début de la seconde saison Max Greevey devient le mort sur lequel on enquête, à la fin de la sixième saison Claire Kincaid a droit à une sortie dramatique et émouvante.
Certains scénaristes prennent aussi un malin plaisir à faire mourir des personnages juste pour déstabiliser les spectateurs. The X Files frappe fort en éliminant à la fin de la première saison Gorge Profonde, personnage très apprécié des fans, juste pour prouver que tout peu arriver dans la série. Il ne fera pas bon être second rôle dans la production de Cris Carter, nombreux sont ceux qui ont passé l’arme à gauche.
Suivant cet exemple Joss Whedon tuera sauvent les personnages apprécié de ses séries mais j’y reviendrais.
La Mort Intime
Au fur et a mesure que le sujet devient moins tabou la mort, ses représentations prennent de plus en plus de place dans les séries jusqu’à en devenir le thème central.
Buffy contre les vampires (Buffy the vampire slayer)
Buffy n’est pas une série dont le sujet central est la mort, même si évoluent autour de la tueuse de vampire des non morts, des revenants, et autres créatures étranges. Pourtant le traitement qu’il est fait de la mort est exemplaire.
Dans le Buffyverse ont meurt très facilement. Whedon prend un malin plaisir, un plaisir sadique à faire mourir les personnages aimés du public, et le plus souvent en nous cueillant à froid. Nous avons appris à voir venir les drames après les moment de bonheur. Jenny Calendar se fait tuer alors que sa relation avec Gilles est sur le point de passer à une niveau supérieur. Tara décède alors qu’elle vient de se réconcilier avec Willow. Dans Angel la mort frappe très tôt avec celle de Doyle au milieu de la toute première saison. C’est sans doute pour se faire pardonner que personne d’important avant la dernière saison (je n’en dirais pas plus pour ne pas gâcher le plaisir de ceux qui n’ont pas encore vu cette ultime saison en espérant que TF6 ne coupera pas trop dans le lard).
Whedon se paie le luxe de faire mourir son héroïne par deux fois (ce sera un running gag dans les dernières saisons) bousculant les téléspectateurs.
Mais si cette série est si exemplaire dans son rapport avec la mort c’est en raison du superbe épisode The Body. Il s’agit toute série confondue du meilleur épisode sur le sujet. Pas tellement dans son traitement de la mort mais de ce qui se passe pour ceux qui restent. Dans une série où la mort est violente, liée au force de l’ombre, aux démons, à la magie, la mort de la mère de Buffy est pour une fois réaliste, et traitée de façon réaliste. Joyce succombe à la maladie, il n’est pas question de manifestations paranormale dans son décès. Par le fait l’épisode va être atypique, sans musique, sans intrigue, il est une chronique de l’après, tous les personnages doivent pour une fois faire face à une mort naturelle, ils doivent apprendre à vivre avec, à accepter. Il est fort instructif d’écouter le commentaire audio de Whedon sur le DVD pour mieux saisir ses intentions, les enjeux de l’épisode.
Six Feet Under
Homicide puis CSI nous ont fait entrer dans les salles d’autopsie, SFU nous fait pénétrer dans les salons mortuaires et l’industrie de la mort.
Il serrait réducteur de ne voir dans SFU qu’une série sur la mort même si elle est omniprésente. Chaque épisode s’ouvre sur une mort (le premier s’ouvre sur celle symbolique du père de famille Fisher) et nous permet de rentrer chez Fisher & Sons ; Elle n’existe que pour illustrer, éclairer, renvoyer à la vie de ceux qui restent, et en particulier la famille Fisher.
Ce que nous montre SFU ce n’est pas seulement que la mort peut être absurde avec la défilé hebdomadaire des décès. Ça nous le savons déjà mais que la vie, malgré toutes les difficultés, les peines, les coups dur, les blessures vaut la peine d’être vécu et qu’elle réserve aussi des moments de joie si l’on veut bien prendre la peine de la vivre. Il faut dans un premier temps la mort du père pour que le reste de la famille lève enfin le nez de la mort omniprésente dans la famille pour (re)découvrir que le vie existe en dehors des salons mortuaire et qu’il est agréable de la vivre avant de mourir. SFU pourrait reprendre la formule de Desproges “Vivons heureux en attendant la mort” (tiens il me smeble que je l’ai déjà placée celle là). Bien sur le processus de “retour à la vie” sera long, parfois douloureux, mais bénéfique. Et puis si l’on souffre c’est que l’on est en vie.
Dead Like Me
Poussons un cran plus loin dans l’exploration de la mort. Cette fois ci la mort n’est pas juste le centre de la série, les personnages principaux sont morts. Georges Lass n’a pas de chance puisqu’elle meurt au début de la série (écrasée par les toilettes de la station Mir). Comme il aurait été de continuer une série dont l’héroïne meurt à la fin du premier acte nous allons la suivre dans son après vie.
Donc Georges est morte, mais pas totalement, elle devient un grim reaper, une faucheuse, chargée de récolter l’âme des personnes sur le point de mourir dans des accidents (ce qui nous donne une autre occasion de voir défiler des morts absurdes). C’est un lourd fardeau, ce n’est pas un job facile, mais ça lui permet de profiter encore des plaisirs de la vie, ceux là même qu’elle n’a pas su cueillir du temps où elle était bien en vie.
Comme dans SFU dans DLM les morts servent à illustrer la beauté de la vie, les faucheurs ont des leçons à apprendre d’eux, et pas seulement Georges.
La mort en entrant dans le monde des séries leur apporte une dose de réalisme et leur offre un champs d’exploration supplémentaire, fantaisiste ou réaliste, mais offrant toujours des moyens de réflexion sur ce qui est indissociable de la mort, la vie.
Rendez vous dans un mois pour la chronique de Noël où il sera question de beaux cadeaux.
 LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires
LTE || La Ligue des Téléspectateurs Extraordinaires